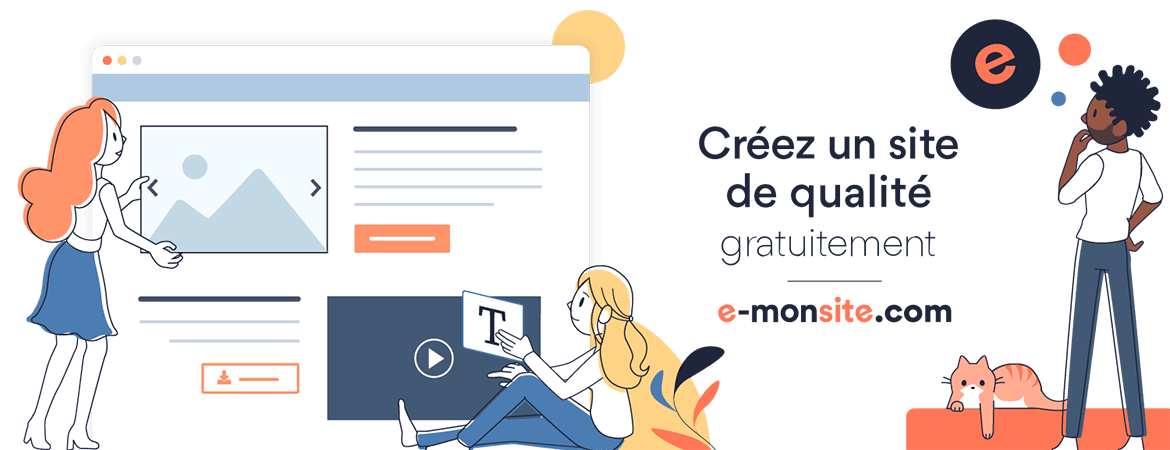Année : 1891
5 janvier.
Vu, ce matin, Daudet. Il dit de Vignier : « Il porte la mort de Robert Caze en bandoulière », de Zola, qu'il travaille tant qu'il en est tout noir.
Goncourt, parait-il, a lu Sourires pincés et va m'écrire...
Il est plein d'une grande pitié pour les pauvres honnêtes, pour les femmes qui savent résister aux besoins de l’entrecuisse. Il s'est battu deux fois en duel, l'une, au pistolet, l'autre, à l'épée, avec Delpit qu'il a blessé au ventre et au bras. Au duel Drumont-Meyer, après que Drumont fut blessé, Daudet quittait sa veste et demandait à se battre à son tour...
Mme Daudet : une femme bien plus artiste que moi, la femme d'art par excellence.
Il a peur que ses enfants héritent de sa maladie, et sa pièce L'Obstacle lui a été particulièrement douloureuse à faire. Il a dit :
-- Je voudrais mourir de pitié comme je ne sais plus quel roi ancien, auquel on avait amené des captifs si misérables qu'il en est tout de suite tombé malade.
10 janvier.
Quelque intégrité que nous ayons, on peut toujours nous classer dans une catégorie de voleurs.
12 janvier.
A la salle d'armes : il dégèle sur les torses.
13 janvier.
A tes cils pendent comme des gouttes de sommeil.
19 janvier.
Hier soir, onze heures 1/2, on sonne. C'était M. Marcel Schwob, qui me demande, à travers la porte, « un conte pour L'Écho de Paris ». Dans l'éclairage de deux bougies, je vois une figure ronde, une tête déjà chauve. Nous cherchons en vain dans mes papiers.
Schwob voulait m'emmener tout de suite à l'Écho de Paris, comme j'étais, nu-pieds, en chemise de nuit.
J'ai raté une belle occasion, quoi !
3 février.
Hier soir, dîner des Symbolistes. Toasts multiples, préparés, improvisés, lus, bredouillés. Mot de Barrès : « Nous avons tous au fond du coeur le pétard antisymboliste. » Je trouve Barrès gélatineux. La barbiche de Félix Fénéon.
Il y avait un monsieur rigidement plastronné, avec une grosse chose blanche à la boutonnière. On eût dit le garçon d'honneur du symbolisme. On lui demandait : « Pourquoi êtes-vous là ? » Il répondait : « Je viens de me faire retoquer à mon bachot. En sortant de la Faculté, j'ai vu qu'on donnait un banquet d'hommes de lettres. Je me suis payé ça. » Une chose le surprenait. « Comment ! Il est onze heures, et vous avez encore le temps de faire passer des articles dans les journaux ! »
Mendès, c'est la pédérastie dans le geste. Mirbeau, un type d'adjudant d'artillerie. Marie Krysinska, une bouche à mettre le pied dedans.
Raynaud n'était pas content du dîner, et disait : « On n'a pas seulement eu le temps de se saouler un petit peu. »
Vanor. Ce garçon-là donne des poignées de main avec un talent !... Il est de première force dans les saluts de tête et les sourires sympathiques.
Moréas. Ses cheveux lui tombent dans les moustaches.
Jean Carrère. Un Lamartine méridional. Il croit à l'idéal, à l'infini, à Job, à un tas de pauvres choses et, pour faire la preuve, récite de ses vers. En outre, il voudrait bien être pris pour un barbare, et croit qu'à l'apparition de son volume de vers, tout le monde va lui tomber dessus. Louis Denise, d'ailleurs, l'a bien prévenu.
Léon Lacour, déjà gris, déjà chauve, et toujours tout petit Ah ! ceux qui prennent la littérature pour une nourrice se portent mal.
Tous ces gens-là disent : « Je suis un révolté, moi », avec un petit air de vieillard qui vient de faire pipi sans trop souffrir.
4 février.
Oui ! Je leur parlais, aux étoiles, en un langage choisi, peut-être en vers, et, les bras croisés, j'attendais leur réponse.
Mais ce furent des chiens en cercle, de maigres chiens, qui me répondirent en hurlements monotones.
13 février.
Une nouvelle presque très bien, quelque chose comme un sous-chef-d'oeuvre.
Ah ! la vie littéraire ! Je suis allé ce soir chez Lemerre. Je n'y vais pas souvent, par timidité. Aucun Sourires pincés n'était en montre. Tout de suite, il m'est venu cette idée d'imbécile que les 1000 exemplaires étaient peut-être épuisés. Quand je suis entré, le coeur me battait un peu.
Lemerre ne m'a même pas reconnu.
16 février.
Marcel Schwob n'a pas vingt-quatre ans. Il en porte joie. Il a été refusé à l'École Normale par de La Coulonche, pour le discours français, naturellement. Il a été reçu le premier à la licence, avant les normaliens qui s'étaient présentés à Normale en même temps que lui. Il n'a jamais écrit une ligne qui ne fût payée, et il est entré à L'Événement en écrivant, de province, à Magnier, pour lui offrir de faire des chroniques. Il a le mépris des cheveux et se fait presque raser la tête. C'est un journaliste du genre savant et de l'espèce rare, un travailleur qui veut des choses, croit à des choses, méprise des choses ; un indéchiffré encore pour moi.
18 février.
Prochain volume : les Cloportes et l'Écornifleur réunis. Premier chapitre : les Lérin, deuxième chapitre : les Vernet.
Le style de Huysmans, c'est comme une brosse dure, et ça gratte, et il y a des crins très gros, très grossiers.
21 février.
Mettre entre les Lérin et les Vernet quelques fantaisies intitulées : Entr'acte.
23 février.
George Sand, la vache bretonne de la littérature.
Nous passons par des états de corps étranges, comme si la mort nous faisait des signes de tête amicaux.
24 février.
Une signature tremblée qui a peur de dire son nom.
25 février.
Ce matin, bonne conversation d'une heure et demie avec Alphonse Daudet. Il souffrait moins, marchait des pas presque naturels, était gai. Goncourt lui a dit : « Dites à Sourires pincés que je ne l'oublie pas, que je lui écrirai quand j'en aurai fini avec la Fille Élisa. » Goncourt n'est pas au-dessus des petites misères de la vie littéraire. Un article méchant de Bonnières au Figaro l'a profondément froissé. Il en reste nerveux longtemps. Cela devrait pourtant le faire sourire, car il est dit dans cet article que, tout ce qu'il peut y avoir de bon, c'est Ajalbert qui l'y a mis !
-- Connaissiez-vous Victor Hugo ?
-- Oui, j'ai dîné souvent avec lui. Il me prenait pour un rieur. Je buvais presque autant que lui mais j'ai toujours refusé de lui donner mes livres. Je lui disais : « Vous ne les lirez pas, cher maître, et vous me ferez écrire par une des femmes qui vous font la cour. » Je me suis entêté à garder ce rôle, et Victor Hugo est mort sans me connaître. Mme Daudet était une toute petite fille à la table d'Hugo. Elle n'osait rien dire, par crainte sans doute d'être confondue avec les pimbêches qui entouraient le maître. Au fond, cette timidité, c'était de l'orgueil. Je vais tous les dimanches chez Goncourt. Cela me coûte, mais j'y vais. Il est tellement seul, si peu entouré ! C'est moi qui ai fondé son Grenier.
« Avec l'instantané on ne fait que du faux. Photographiez un homme dans sa chute : vous en obtenez un moment, mais rien qui ressemble à une chute.
« J'ai pris l'habitude d'écrire tout ce qui me passe par la tête. Une pensée, je la note au vol, qu'elle soit malsaine ou criminelle. Il est évident que ces notes ne donneraient pas toujours l'homme que je suis. Nous sommes irresponsables des bizarreries de notre cervelle. Nous ne pouvons que chasser l'immoral et l'illogique, mais non l'empêcher de venir.
« Un jour, j'avais écrit que nos premières impressions sont les seules ineffaçables. Le reste n'est qu'une répétition, un effet de l'habitude. Le lendemain, j'ai trouvé cette page rayée à coups d'ongles : Mme Daudet l'avait lue indiscrètement, et elle s'était fait ce petit raisonnement en apparence très simple : « Il a dit : « Je t'aime » à d'autres femmes que moi. Je suis venue après elles. Quel est donc le degré de sincérité de ses paroles d'amour ? »
« La vie, c'est une boîte d'instruments qui piquent et coupent. A toute heure nous nous ensanglantons les mains.
« Je me suis marié jeune, avec 40 000 francs de dettes, par amour et par raison, par crainte de la noce et du collage. Ma femme avait une centaine de mille francs. Nous avons d'abord payé mes dettes, puis nous en sommes arrivés à mettre « au clou » les diamants de Mme Daudet. Elle tenait ses comptes en bonne ménagère, mais le mot de mont-de-piété lui faisait peur, elle inscrivait sur son livre : Là-bas.
« Un jour Glatigny arrive. « Je viens partager ton déjeuner », me dit-il. Je lui réponds : « Je suis très heureux que tu arrives trop tard, parce que je n'avais qu'un petit pain d'un sou, et ma foi ! j'en avais juste assez. » Glatigny m'a entraîné chez Banville, auquel nous avons emprunté quarante sous.
« Banville, un homme que je ne connais pas encore. Il n'écoute pas, n'éprouve aucun plaisir à « feuilleter un esprit », et, comme les acheteurs, n'attend de votre phrase que le mot qui doit provoquer sa réponse. C'est un homme plein d'anecdotes qu'il raconte fort bien, qui sont la plus belle part de son talent, mais que je n'ai pas de plaisir à voir. Et nous nous connaissons depuis 1856 !
« Ne vous occupez donc pas de votre famille ! On n'arrive jamais à la satisfaire. Mon père entendait une pièce de moi. Un monsieur qui se trouvait près de lui avant dit : « C'est embêtant ! » mon brave père a tout de suite pris cet avis pour décisif, et le succès de la pièce, les articles de journaux, rien n'a pu modifier cette opinion qu'il devait à quelque imbécile. Une autre fois, mon fils avait passé une soirée avec quelques-uns de mes ennemis, qui ne s'étaient pas gênés pour me débiner. Il m'a fait une tête !... Je l'ai écrite, sa tête, dans mes notes, et, un jour, le pauvre garçon saura ce que j'ai pensé de lui ce soir-là. Ce cahier est pour lui, et je ne veux pas qu'on le publie jamais. Il le lira après ma mort.
« Mon fils Léon est un esprit de premier ordre. Il a écrit des choses très bien qu'il a le courage de ne pas publier. Est-ce beau !
« Vous arriverez, Renard. J'en suis sûr, et vous gagnerez de l'argent, mais il faut tout de même, pour cela, que vous vous donniez de temps en temps quelques coups de pied au cul...
« Les Symbolistes, quelles gens absurdes et pauvres ! Ne m'en parlez pas ! Il n'y a rien d'abscons. Tout homme qui a du talent arrive, et je crois fanatiquement que chaque peine a son salaire. Venez donc le jeudi. Vous trouverez des gens froids, et d'autres qui, comme Rosny au puissant cerveau de savant, vous étourdissent de leurs paroles. »
J'ai serré vivement la main de Daudet et en lui disant : « Cher Maître, me voilà remonté pour longtemps. »
Un mari voit un monsieur qui serre de près sa femme.
Le mari : -- Dis-lui donc de finir !
La femme : -- Ah ! dis-lui, toi. Moi, je ne le connais pas, ce monsieur.
1er mars.
Vu Gustave Geffroy. Un timide noir. Ajalbert lui a, à lui aussi, parlé de ma férocité ; il me fera une réputation que j'aurai de la peine à défaire. Geffroy est, en instantané, un charmant garçon, mais on ne lit pas grand-chose sur sa figure. Il l'a trop petite, et il a trop de barbe. Comme tous les journalistes il se plaint du journalisme. A sa place à La Justice et y reste. N'a pas réussi au Gil-Blas.
3 mars.
Nettoyer les écuries d'Augias avec un cure-dent.
5 mars.
Hier, chez Daudet, Goncourt, Rosny, Carrière, Geffroy, M. et Mme Toudouze, M. et Mme Rodenbach. Pourquoi suis-je sorti de là écoeuré ? Je m'imaginais sans doute que Goncourt n'était pas un homme. Faut-il retrouver chez les vieux les petitesses des jeunes ? A-t-on assez arrangé le pauvre Zola, jusqu'à l'accuser de tourner au symbolisme ! Et Banville, « ce vieux chameau », comme l'appelle Daudet, qui dit encore, mais cette fois avec esprit : « Si j'avais fait l'arbre généalogique de Zola, on m'aurait trouvé un jour pendu à l'une de ses branches !... »
Goncourt, un gros militaire en retraite. Je n'ai pas vu son esprit : ce sera pour une autre fois. Jusqu'à la seconde impression, c'est l'homme des répétitions que je trouve si insupportables dans l'oeuvre des Goncourt. Rosny, un bavard savant, éprouve un vif plaisir à citer du Chateaubriand, spécialement les Mémoires d'outre-tombe.
Carrière, un monsieur qui serre la main des autres le plus près possible de la cuisse.
Rodenbach, un poëte qui trouve que nous manquons de naïveté, qui a pris au sérieux l'article de Raynaud sur Moréas, et qui ne se reconnaît plus dans les ironies de Barrès. On lui a demandé des vers. Il a fait le difficile. On a insisté. Il a eu l'air d'en chercher ; on l'a oublié. On a parlé d'autre chose et il n'a pas dit ses vers... .
Mauvaise, cette journée d'hier. A l'Écho de Paris on a trouvé trop fine ma nouvelle le Navet sculpté, et moi je n'ai pas trouvé nos grands hommes assez fins. Elle ne passera pas.
Il y a aussi un petit album offert par Mme Dardoize à Lucien, le plus jeune des fils Daudet : tous les invités sont priés d'essuyer leur plume en entrant. J'ai mis, moi :
« Le rayon de soleil vint se jouer sur le parquet. L'enfant le vit et se baissa pour le prendre. Ses ongles se cassèrent. Il cria douloureusement : « Je veux le rayon de soleil ! » et se mit à pleurer, rageur, en frappant du pied.
« Alors, le rayon de soleil s'en alla. »
Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Mme Dardoize. On ne trouve plus l'amour de la jeunesse et de la vie que chez les très vieilles femmes...
Rodenbach raconte que Charles Morice s'est présenté à Ferrari, directeur de La Revue bleue, et lui a dit : « Monsieur, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. » Puis, tirant de sa redingote profonde un petit papier : « 1°. Le symbolisme. 2°. Racine, mon cher Racine (ici, un temps). 3°. La nature et le symbole. 4°. Le symbole et la nature. Ce n'est pas la même chose. Il y aurait comme cela trente-six articles. »
Daudet dit :
-- Les écoles, c'est spécial à la France. J'aurais eu beaucoup plus de succès si j'avais voulu monter une boutique en face de la boutique à Zola. Mais nous nous sommes laissé associer avec lui, par indifférence, et aujourd'hui toute la presse est pour Zola. Il n'y a de gloire que pour lui.
Il parle du roman de Banville Rable. Ce sont des cris contre ce monsieur qui veut faire du roman sans documents. Goncourt dit :
-- Quant à moi, je n'ai pas encore pu entrer dans cette pâte compacte...
Rodenbach dit :
-- Anatole France, parce que sa génération n'a pas voulu de lui, s'est tourné vers les jeunes et leur a dit : « Vous savez, je suis des vôtres. »
7 mars.
Qu'est-ce que vous avez à rire ? Poseur, va !
-- Que ne dites-vous vrai !
Je ne lis rien, de peur de trouver des choses bien.
Mon sourire a la jaunisse.
Hier soir, Schwob et moi nous avons mis notre coeur à nu.
C'est une haute intelligence qui a passé par bien des crises. Il a même voulu s'empoisonner.
-- Pendant deux minutes, dit-il, avant de vomir, j'ai touché à la mort.
Il me dit :
Vous m'avez paru méchant, tout d'abord, entier, insupportable, et, malgré l'admiration que j'ai pour vous, je souffrais, ce soir, en venant dîner. Je souffrais à l'avance de vos contradictions.
Le cerveau n'a pas de pudeur.
Portrait de Schwob. Voilà un isolé. Il pense que nous arrivons tard et qu'il ne nous reste qu'une chose à faire après nos aînés : bien écrire.
Il dit : « Voici ce que je veux dire », se lève, se promène, le dos un peu courbé, et parle. Il a des arches sourcilières, une bonne figure ronde, le moins de cheveux possible, et un parler doux de séminariste distingué.
Les fantômes, racontés par Holmès à Mendès, racontés par Mendès à Schwob pour qu'il en fasse une nouvelle. Schwob a déclaré qu'il ne pouvait rien en tirer.
Un Anglais achète une ferme et veut en prendre possession. Il voit des fantômes -- ceux des anciens propriétaires -- rangés autour du foyer, et leur dit :
-- Allez-vous-en.
Les fantômes refusent. Le fermier va chercher un policeman, puis un pasteur qui répand de l'eau bénite : les fantômes ne veulent pas s'en aller, puis un homme de loi qui leur lit le bail : les fantômes s'en vont.
8 mars.
Été aujourd'hui chez Daudet, d'où nous devions aller voir Rodin, puis Goncourt. J'ai eu le grand malheur, sans doute, de lui déplaire. Aussi, qu'est-ce qui m'a pris de ne pas le complimenter au hasard sur ses livres que je n'ai pas lus ! Salut strict, politesse tout juste ce qu'il faut, et aucune espèce d'invitation, aucun mot de sa femme à l'adresse de ma femme et du bébé. Mon petit, tu as dû faire quelque four. Ah ! la vie nous meurtrit les pieds... Daudet nous parle du chic de son fils Lucien de son « jemenfoutisme » à lui en ce qui concerne sa toilette... d'une paire de pantoufles-chaussettes qu'il a fait faire exprès pour lui, et nous partons.
Chez Rodin, une révélation, un enchantement, cette Porte de l'Enfer, cette petite chose, grande comme la main, qui s'appelle l'Éternelle Idole : un homme, les bras derrière le dos, vaincu, embrasse une femme au-dessous des seins, lui colle ses lèvres sur la peau, et la femme a l'air tout triste. C'est difficilement que je me détache de ça. Une vieille femme en bronze, qui est une chose horriblement belle, avec ses seins plats, son ventre crevassé et sa tête belle encore. Puis des enlacements de corps, des nouements de bras, et le Péché originel, la femme cramponnant Adam, le tirant à elle par tout son être, et le Satyre étripant une femme entre ses bras, une de ses mains entre ses cuisses, ces oppositions de mollets d'homme et de jambes de femme. Seigneur, faites que j'aie la force d'admirer toutes ces choses !
Dans la cour, des blocs de marbre attendent la vie, étranges par leur forme et, il semble, par leur désir de vivre. C'est amusant : moi, je fais l'homme qui a découvert Rodin.
Rodin, un type de pasteur, le sculpteur de la douleur de volupté, questionne naïvement Daudet et lui demande comment il faut appeler ses stupéfiantes créations. Il trouve de petits noms poncifs, dans la mythologie par exemple. Un Victor Hugo nu dans une maquette... d'ailleurs, quelque chose de parfaitement grotesque.
Chez Goncourt : un musée de haut en bas. Moi, j'ai beau regarder : je ne vois rien. Je ne remarque rien. Goncourt est là-dedans chez lui, vieux type de collectionneur, indifférent à tout ce qui n'est pas sa manie. Je regarde des Daumier. Il soulève la moitié du volume que je laisse un peu tomber : « Des fois, ça se casse vous savez. » Il me dit :
-- Si ça vous embête, vous n'êtes pas obligé de les regarder.
La maison n'a pas l'air solide. La porte du « grenier » ferme mal, bat sans cesse, et, avec toutes ces chinoiseries on se croirait dans une des plus riches huttes de l'Exposition universelle.
-- Vous ne fumez pas ?
-- Non.
-- Oh ! c'est pour vous donner un genre.
9 mars.
J'ai connu trois cervelles, dit Goncourt : Gavarni, Berthelot, et un maire de village.
Chez Rodin, il m'a semblé que mes yeux tout d'un coup éclataient. Jusqu'ici la sculpture m'avait intéressé comme un travail dans du navet.
Écrire à la manière dont Rodin sculpte.
Burty, dont on vend aujourd'hui la collection, invitait un jour à dîner Alphonse Daudet, sa femme et Goncourt. Au dessert, il appelait Mme Daudet dans un coin, et lui montrait les Amoureuses, édition originale, introuvable avec une dédicace de Daudet à une femme.
Il n'y a guère que deux mois que Mme Daudet a raconté cette petite histoire à son mari, en le priant de faire acheter à tout prix l'exemplaire.
Burty était un placeur de bonnes : il a fait la guerre à celle de Goncourt pour la remplacer par une de son cru.
Il a écrit un livre, Grave imprudence, seulement pour faire tomber Manette Salomon.
-- Quand Burty avait de mauvaises pensées, dit Goncourt, ça se voyait très bien : il devenait tout gris.
Quand on me montre un dessin, je le regarde juste le temps de préparer ce que je vais en dire.
11 mars.
Hier, à dîner, Alcide Guérin. Voilà ce que c'est, d'inviter les gens sur un article ! Un monsieur complètement chauve, une figure de juif qui serait dévot. Il paraît qu'il fait ses prières, va à la messe, communie, et fait maigre le vendredi. Quand il parle Patrie, il prononce le mot de « douleurs intimes » et il a un ronflement de gorge, presque un roucoulement.
Une voix de châtré.
Il fait de Léon Bloy ce stupéfiant présage : « Attendez-vous à quelque chose de grand d'ici peu. Je considère Bloy comme un saint, en tout cas, comme un homme providentiel. »
Il nous dit, à Raynaud et à moi : « Quand vous serez grands, je vous bénirai. » Et on est tenté de prendre le mot à la lettre.
Il dit : « Moi, je ne suis rien, je ne serai rien. » Il attend qu'on proteste, mais on se tait, et son hypocrisie est obligée de rentrer comme une vilaine limace.
Il a un noeud de cravate qui me rappelle, par sa forme, un chapeau de curé.
Qu'est-ce qu'il fait au milieu des jeunes ? Car il en parle et affirme les aimer. Les séminaristes nouvellement arrivés au régiment doivent avoir une attitude semblable. Quand il s'est mis à table, j'ai cru qu'il allait dire le Benedicite.
Discussion entre Raynaud et moi sur Mallarmé. Je dis : « C'est stupide. » Il dit : « C'est merveilleux. » Et cela ressemble à toutes les discussions littéraires.
Chez Schwob, rien que des livres anglais ou allemands. Il a, en outre, le goût de la criminalité, et l'on voit des brochures de justiciers.
Lu au mur une ballade de Richepin dont voici le dernier vers :
Trinquer du verre et du nombril.
14 mars
Il va peut-être se passer ici quelque chose de terrible. Aujourd'hui le mot de croup a été prononcé par une célébrité à lorgnon et à 40 francs la visite. Après, nous ne savons plus ce qu'il a dit. Marinette pleure, et moi je suis sorti avec une boule dans la gorge. Nous sommes grisés de peur.
Nous écoutons le souffle, tantôt rauque, tantôt sifflant de bébé. Les vomissements lui font du bien, et je voudrais le voir toujours vomir.
Le plus terrible, c'est qu'il est gai. Il rit, et la mort peut-être se prépare. Moi, je fais de la littérature.
Nous nous embrouillons dans les pharynx et les larynx.
15 mars.
Un enfant est en bonne santé. Nous disons : « Je l'aime », tout simplement, mais, quand il est mourant comment expliquer la manière dont, avec ses petites mains, il s'accroche à notre coeur !
Mme Oury, M..., et bébé viennent.
-- Notre enfant est sous une menace de croup.
-- Oh ! ce ne sera rien.
Et ils dégringolent les escaliers, pâles de peur, en agitant les bras et en répétant :
-- Ce ne sera rien ! Ce ne sera rien !
17 mars.
Scène possible. L'enfant est mort. La mère et le père sont en larmes. Mais l'amant prend la main de la femme frappe sur l'épaule du mari et dit :
-- Allons, du courage ! Nous en ferons un autre.
20 mars.
Docteur, mon enfant se meurt du croup.
-- Ah ! Donnez-lui des boules de gomme.
Hier, Schwob est resté jusqu'à deux heures du matin. Il m'a semblé qu'avec des doigts fins il prenait ma cervelle, la retournait et l'exposait au grand jour. Il parlait d'Eschyle et le comparait à Rodin. Il m'analysait Les sept de Thèbes et la rivalité d'Étéocle et Polynice, et la manière géométrique, architecturale, dont cette pièce est composée : tant d'ennemis, contre tant d'ennemis, tant de vers, dix, par exemple, pour chaque chef...
Un moment, la lampe s'est éteinte. J'ai allumé les bougies du piano. Le visage de Marcel Schwob était dans l'ombre.
Je sens que ce garçon-là aura sur moi une influence énorme.
Moi : « Vous ne savez pas ce qu'il faut de courage pour s'empêcher de faire souffrir les autres ! »
Lui : « Moi, j'ai peur de la bêtise de la femme. J'ai pour maîtresse une toute petite fille qui est bien bête, mais si gentiment ! »
Nous nous avouons ceci : quand un être qui nous est cher est malade, et que la mort est toute prête, nous souffrons d'avance des gestes qu'il nous faudra faire pour montrer notre douleur, mais nous ne pensons pas à l'être qui nous est cher.
C'est mauvais, cette habitude que nous avons de refouler les larmes quand il faudrait les laisser couler. Des fois, elles remontent sans que nous sachions pourquoi, et nous nous trompons : nous pleurons à côté.
23 mars.
Balzac est peut-être le seul qui ait eu le droit de mal écrire.
24 mars.
Le symbolisme. C'est toujours le « nous ferons route ensemble » des voyageurs qui partent en même temps. A l'arrivée, on se sépare.
25 mars.
L'autre soir, au cercle d'escrime, Aurélien Scholl, qui présidait disait :
-- Nous allons faire ouvrir : il fait trop chaud.
Et tout le monde se mettait à rire.
Et Aurélien Scholl riait aussi.
31 mars.
Remplacer L'Écornifleur par Le Flagorneur.
7 avril.
Le style, c'est l'oubli de tous les styles.
8 avril.
-- Allons, dégoisez !
-- Insolent !
-- Mais, chère madame, « dégoiser » se dit du ramage des oiseaux.
10 avril
Il m'est venu à l'idée de faire de L'Écornifleur une des attitudes de Poil de Carotte ; quelque chose comme ses expériences sentimentales. Ce serait mon Tartarin à moi. On aurait Poil de Carotte de trois à douze ans, Poil de Carotte à vingt ans, et, plus tard, Poil de Carotte de douze à vingt ans.
13 avril.
Une des cent mille manières de recevoir un compliment : « Ça me fait plaisir, parce que je sais que vous êtes un indépendant. »
15 avril.
Mot de Gloriette : « Si je savais que je vais mourir, j'en mourrais à l'avance. »
Schwob m'apprend que L'Écho de Paris aura un supplément littéraire et que Mendès l'appelle à la direction. Je félicite Schwob comme un oncle à héritage, et mon affection pour lui ne m'empêche pas de songer à l'utile.
Daudet, en verve, nous parle des embarquements de Gauguin, qui voudrait aller à Tahiti pour n'y trouver personne, et qui ne part jamais. Au point que ses amis les meilleurs finissent par lui dire : « Il faut vous en aller, mon cher ami, il faut vous en aller. »
Le critique, c'est un botaniste. Moi, je suis un jardinier.
17 avril.
Un homme tellement beau que lui-même se trouve ridicule.
Oui, en effet, j'ai dit que vous aviez du talent, mais je n'y tiens pas.
21 avril.
Formule nouvelle : l'enfant pleura comme un homme.
Tout de même, on se repent des torts irréparables, des torts qu'on a eus envers des gens qui sont morts.
22 avril.
Un mot entendu par le père de Schwob.
Au théâtre, un bonhomme est à côté d'un monsieur au nez difforme. Tout à coup, il se tourne vers lui :
-- Tenez, j'aime autant vous le dire : il y a un quart d'heure que votre nez m'embête.
L'homme au nez difforme :
- Et moi, monsieur, il y a vingt-cinq ans !
J'en ai assez, de me faire petit devant les autres.
Visité ce soir l'exposition d'Eugène Carrière. La folie douloureuse des fillettes, des jeunes filles, qui ont le joli, le gracieux effrayant des folles gaies. Des mères malades et folles qui donnent de vilains seins, mal dessinés, à leurs enfants. Un bébé qui a des fleurs rouges dans la tête et qui a l'air d'un poussah hideux. Pose fréquente : appuiement de la tête sur la main. Le collage des chairs. Des figures comme taillées dans la pierre. Geffroy, ce mélancolique silencieux, prétend que toutes ces têtes-là pensent. Je ne crois pas : bien plutôt, elles ne pensent plus. Elles sont presque mortes, inertes, comme après une effroyable catastrophe. « La vie est-elle donc une chose rigolote ? » dit Geffroy. Et puis, zut ! Ces gens-là nous entraîneraient dans des trous. Ils sont intéressants, mais on ne sait plus. On arrive très bien à s'extasier devant eux. Là où le peintre n'a peut-être cherché qu'un effet de lumière ou de ligne, nous voyons des choses, de l'Au-delà. Croûte égale chef-d'oeuvre. On est ivre. Il faut absolument se dessaouler et s'en aller. Le grand art n'est pas là.
24 avril.
Hier soir, chez Daudet. La petite fille, paraît-il, a fait, du coq en carton qu'on lui a donné, une personne morale qui s'appelle « le coq de M. Renard » et avec lequel elle tient des conversations. La splendide Jeanne Hugo, avec son merveilleux nez, un nez de grande race, à la Victor Hugo. Goncourt parle, avec une bonhomie qui me paraît fausse (pourquoi ?) de l'insignifiante vente de ses livres, dont quelques-uns ont pourtant fait un potin à la Drumont.
Rosny cause intarissablement de sa bête noire, Huysmans. J'entends : « Pour vomir son temps, il faudrait d'abord l'avoir mangé. Chacun est un révolté, de nos jours. » A ce propos, Daudet dit :
-- Moi, j'ai refusé d'entrer à l'Académie. On ne me prendra jamais pour un révolté. Pourquoi ?
Charpentier, qui prétend lire tous les manuscrits.
Margueritte, un garçon très grand, très doux. Toudouze, qui me cherchait partout pour me remercier, avec la même ardeur, sans doute, que je mettais à sa recherche.
Un monsieur glabre qui me parle tout le temps de mon livre. Comme je le trouverais insupportable s'il me parlait d'autre chose !
Daudet me dit de Schwob : « Il a la tête toute pleine »
Carrière, dont les paroles ont le gris, l'incertain, l'inachevé de ses tableaux.
Un homme écrit une lettre d'amour à une femme qui ne lui répond pas.
Il cherche les raisons de ce silence.
Il finit par trouver ceci :
-- J'aurais dû mettre un timbre dans la lettre.
26 avril.
Ferdinand Fabre, ou l'homme qui veut tous les prix de l'Académie.
Faire de ses rêveries des pensées.
27 avril,
Hier, au Moulin-Rouge, au Moulin de la Galette. Cela fait mal, de n'être rien pour la femme qu'on trouve jolie. Une petite fille en chaussettes, jambes nues, faisait le grand écart. J'aurais accepté d'être son souteneur. J'aurais voulu être aussi le chef d'orchestre, le chef de tout cela. Oh ! les pustules de la vanité !
30 avril.
Schwob me raconte que Rémy de Gourmont est venu pleurer dans le sein de Mendès. Son article sur le patriotisme l'avait fait mettre à la porte de la Bibliothèque nationale, et il avait ses poches pleines de choses à reproduire dans le Supplément de l'Écho de Paris.
Schwob dit : « C'est peut-être dans la Bible qu'on trouverait des procédés littéraires nouveaux et l'art de laisser les choses à leur place. »
1er mai.
Qu'est notre imagination, comparée à celle d'un enfant qui veut faire un chemin de fer avec des asperges ?
2 mai.
Acquiers le talent de dire sans bâiller : « C'est intéressant. »
Vu ce matin Richepin. Un gros chien frisé très doux. Un veston rouge, des bas, des jarretières, une culotte, et il est nu dans une chemise ouverte. Deux chiens. Un jardinet devant, un autre derrière.
Deux doigts de la main chargés de bagues.
Aime Chateaubriand, Rosny, et trouve les Goncourt surfaits.
Le bon homme qu'est Rodin nous dit naïvement : « J'ai été l'élève de Barye, mais je ne le comprenais pas. Il me semblait trop simple pour être un grand artiste. »
7 mai.
Prendre par le cou l'idée fuyante et lui écraser le nez sur le papier.
Je sens très bien que je vais être tourmenté par la phrase. Un jour arrivera où je ne pourrai plus écrire un seul mot.
Ma crainte était de n'être, plus tard, qu'un Flaubert de salon, inoffensif.
8 mai.
Cette phrase de Huysmans, cette phrase-chariot. Il me semble, quand je lis, qu'on m'oblige à courir dans des ceps de vigne.
9 mai.
Tout est beau. Il faut parler d'un cochon comme d'une fleur.
16 mai.
Vu, hier, l'exposition Monet. Ces meules avec leur ombre bleue, ces champs bariolés comme des mouchoirs à carreaux.
18 mai.
Revu M. Rigal. Rien de plus douloureux que de revoir un ancien maître en mendiant.
22 mai.
Vu ce matin Barrès. La conversation sur Mallarmé. Cela rapportera des millions, le Grand OEuvre. Mallarmé disant à sa femme et à sa fille : « Maintenant, vous pouvez y aller : je suis sûr de moi », et les deux femmes ont jeté par la fenêtre les quelques sous.
-- Mais où en êtes-vous du Grand OEuvre ? lui dit Barrès.
-- Tenez ! dit Mallarmé en lui montrant sur sa table un amoncellement de papiers.
Il s'absente, et Barrès, curieux, feuillette : les copies des élèves de Mallarmé !
On ne peut pas fréquenter Mallarmé sans avoir du génie.
Une réunion des Symbolistes d'après Barrés. Dîner glacial. « Le continuateur de Pascal : Théodore de Banville », dit Morin. Éclats de rire.
« Si nous ne voulons pas nous prendre au sérieux, allons-nous-en ! » dit l'un d'eux.
Finie, la forme du roman. Barrès méprise les paillettes de l'esprit. Ne refera plus de Renan et a préparé un « Taine en voyage » qu'il ne publiera pas. N'aime que les idées, la métaphysique, qui le grise, et dont on peut jouir sans comprendre.
Prépare des dialogues à la Sénèque.
24 mai.
Voyage à La Châtre, un pays dont George Sand est la Sainte Vierge. Elle y avait son boucher, son pâtissier, plus un coiffeur qu'elle emmenait à Nohant pour trente jours.
J'ai voyagé, aller et retour, avec Henry Fouquier, et j'ai eu la force de ne pas lui demander son nom afin qu'il me demande le mien. Causer littérature sans savoir avec qui, c'est le meilleur mode pour conserver de bonnes relations littéraires.
Elle est assise, George Sand, dans sa pose de Comédie-Française, en plein square. Le clerc boiteux qui nous conduit ne peut pas passer devant une maison sans dire le nom du propriétaire, la valeur de l'immeuble, son histoire, et quels héritiers le guignent. Il nous raconte que, le jour de l'inauguration de la statue de George Sand, Mme J.-B. Clesinger, sa fille (Solange), vexée qu'on n'eût pas accepté le buste de son mari, le tenait à une fenêtre, en face de la foule, entouré de couronnes et de drapeaux. Il ajoute que les oeuvres de George Sand rapportent à ses héritiers de 40 à 50 000 francs par an, ce qui ne les empêche pas de laisser se perdre la propriété de Nohant et de faire couper des arbres historiques, des arbres sur l'écorce desquels, dit-il, George Sand avait certainement dû écrire quelque chose.
« En plein travail, dit Fouquier quand nous revenons, George Sand était capable de se lever parce qu'elle avait besoin d'un homme. Elle faisait de la copie comme on fait des planches. » Sa fille, Solange, était un type plus curieux encore. A la fois artiste noceuse et femme d'ordre, elle disait à Fouquier, à six heures du matin, à la fin d'un bal : « Je m'en vais, parce que je veux voir ce que font mes servantes. »
Une mémoire presque aussi tenace que celle de George Sand, c'est celle du grand-père de Marinette, du vieux roulier Morneau. Le clerc n'en finit pas : « Tenez, ça, c'était à lui, ça aussi, puis ça, et puis encore ça enfin, tout ça, quoi ! »
Eh ! bien, de « tout ça », il ne reste à Marinette : 1° que la moitié d'un terrain -- dit l'acte, -- en réalité, d'un petit coin infect où se tasse tout le fumier des gens et des bêtes, 2° d'une maison étrange. Au rez-de-chaussée, c'est la cave où il y a un puits, et c'est là que s'est logé un des octrois de la ville. Quand on fait trop de feu, la fumée ne se donne pas la peine de monter : elle passe par les crevasses du mur. Elle est tout de suite dehors.
Derrière, il y a un mur que le voisin ne voulait pas laisser construire, et que le grand-père Morneau a fait élever en une nuit : c'est le mieux fait, le plus solide. Voilà un tour !
Sans renseignements, dans cette propriété j'avais vu un château. C'est la plus triste masure de tout la Châtre. L'usufruitière qui la laisse tomber habite une petite propriété bien entretenue qu'elle soigne comme son souffle. La vieille femme tient une petite épicerie, et s'imagine qu'on la vole. Quand elle est chez elle, elle entrecroise, dans un ordre précis, des balais devant ses portes. Si elle est dans son jardin, elle attache le loquet de la porte à un arbre, avec une ficelle. Elle a acheté cette propriété, et cette dette pèse sur toute sa fin de vie. Elle pleure ou nous fouille de ses petits yeux. Nous voulons lui racheter l'usufruit de notre masure. Elle voudrait bien de l'argent, mais l'idée de n'avoir plus une chose même qui lui est à charge, la bouleverse. Elle dit : « Alors, quand vous m'aurez donné de l'argent, je n'aurai plus rien, moi ! Je n'aurai plus rien ! »
Elle avait cueilli un petit bouquet pour Marinette, mais, à la dernière minute, elle oubliait de me le donner.
Il y a à La Châtre deux meuniers, deux frères. L'un a épousé une femme riche et est ruiné ; l'autre a commencé avec rien, et son moulin vaut un million. Les deux moulins sont à quelques pas l'un de l'autre, et, cette ruine à côté de cette jolie chose, c'est tout à fait moral. Le clerc nous dit : « Le riche ne surveillait pas le départ de ses charretiers. Ils emportaient des sacs d'avoine et les vendaient. Voilà le bénéfice de la journée mangé. Le pauvre, au contraire, se levait matin. » Ces deux moulins, c'est toute la vie en deux leçons.
26 mai.
Vous me faites bleuir.
Moréas dit : « Je ressemble à Racine. »
Chaque matin songer aux gens qu'on va cultiver, aux pots qu'il faut arroser.
28 mai.
Présenté hier à Mendès. Il me dit : « Vous avez un roman ? Apportez-le donc. Il passera dans cinq ou six ans. »
Schwob me raconte :
-- Un jeune homme va demander un emploi à un banquier, qui le met à la porte. Le jeune homme, en passant dans la cour, ramasse une épingle. Le banquier le fait rappeler, le traite de voleur et le remet à la porte. C'est un peu plus humain et logique que l'histoire Laffitte.
Dîner Barrès. D'Esparbès nous raconte Alphonse Allais soldat.
Un jour, il voit le drapeau du régiment dans un coin et se précipite en demandant : « Où est l'ombre, l'ombre du drapeau ? »
Il avait comme caporal un Corse, nommé Bellagamba qu'il appela tout de suite « monsieur Bellejambe ». Il arrivait à l'exercice traînant son fusil par la baïonnette et, à chaque instant, il sortait des rangs pour regarder les autres quand le caporal disait :
« Un tel, rentrez le ventre. »
Un jour, il dit au caporal :
« Monsieur Bellejambe, il fait beau, ce matin. Le ciel est pur, les oiseaux chantent. Moi, je m'en vais. » Et il quitta les rangs, traînant toujours son fusil par la baïonnette.
Tout cela avec un air ahuri. Son colonel lui pardonnait tout et finit même par le laisser aller. Sur vingt-huit jours, il en a fait cinq ou six.
Barrès, avec l'air de nous demander si c'était assez, nous dit que L'Éclair lui payait 400 francs un article de quinze lignes.
Un mot d'Allais : La nuit tombait. Je me penchai pour la ramasser.
Charles Morice, depuis dix ans, est le portier du symbolisme. Il est là, sur le seuil, et c'est par lui que le jeunes entrent dans la vie littéraire.
Le crâne de Barrès, c'est un peu celui du corbeau d'Edgar Poe.
Ne jamais être content : tout l'art est là.
16 juin.
Dirait-on pas qu'on est obligé de faire un roman comme ses vingt-huit jours !
18 juin.
Soyez tranquille ! Je n'oublierai jamais le service que je vous ai rendu.
15 juillet.
Je ne vous suivrais pas, même pour aller au bout de monde.
29 juillet.
L'Écornifleur, c'est l'histoire d'un jeune homme insupportable qui parle tout le temps et ne prouve rien.
30 juillet.
La guerre n'est peut-être que la revanche des bêtes que nous avons tuées.
31 juillet.
Croirait-on qu'un livre a sa pudeur, et qu'il ne faut pas trop parler de lui ?
1er août.
Seigneur, aidez-nous, ma femme et moi, à manger notre pain quotidien de ménage !
3 août.
Si on reconnaît « mon style », c'est parce que je fais toujours la même chose, hélas !
8 août.
Ma tête biscornue fait péter tous les clichés.
7 octobre.
Schwob : « Oui, publiez L'Écornifleur. On vous attend. Tout le monde prétend que vous manquez d'haleine. Rosny me disait ce soir : « Oui, sa supériorité dans les petites choses est incontestable, mais il faudrait le voir dans les grosses. »
Capus : « Pourquoi voulez-vous qu'Ollendorff refuse L'Écornifleur? Il publie un volume par jour. Est-ce qu'on a jamais vu un éditeur refuser un livre ? »
8 octobre.
En somme, on a toujours un « roulement » d'amis suffisant.
Schwob me dit : « Daudet doit avoir des foucades. Oui, il est tel moment où il doit prendre les gens en horreur, vous et moi, les autres. Un jour, à Champrosay, j'ai essayé de lui parler de L'Écornifleur : il est resté d'un froid, disant simplement parfois : « Oui, oui », mais avec un ennui visible. Peut-être a-t-il peur de nos demandes. Peut-être aussi, comme vous m'avez introduit chez lui, serait-il heureux de constater que je vous lâche et que je prends votre place auprès de lui. Il ne faut pas retourner le voir sans qu'il vous invite. »
9 octobre.
Une jeune fille victime d'un accident dû à la bienveillance.
Le vrai bonheur serait de se souvenir du présent.
Quel ménage ! Vous n'avez pas fini vos roucoulements ? On se croirait chez un marchand d'oiseaux !
10 octobre.
Quelque chose comme un clair de soleil.
Hélas ! Il me suffit encore qu'un homme me dise qu'il est honnête pour que je le croie.
Au moins, j'ai eu une audace dans L'Écornifleur; j'ai mis « porte-monnaie » au lieu de « bourse ».
13 octobre.
Un homme se console d'être doux en affirmant qu'il est féroce quand il s'y met.
Peut-être que les gens de beaucoup de mémoire n'ont pas d'idées générales.
15 octobre.
Un duel, ça a l'air d'être la répétition générale d'un duel.
16 octobre.
J'ai vu, monsieur, sur une table de boucher, des cervelles pareilles à la vôtre.
18 octobre.
Hier, dîné chez Descaves avec Huysmans, Bonnetain. Huysmans, naturellement, tout autre que je pensais. Grisonnant, barbe en pointe, traits durs et nets. On le reconnaîtrait à sa haine pour Rosny. Cause parfums avec les dames de lettres imprégnées de cantharide, et qui empoisonnent. Met Lyon au-dessus de Paris. Intéressant amusant, produit de l'effet, mais le reproduit dix fois... Il disait :
-- Meyer, du Gaulois! Il nous priait de passer au bureau du journal, Maupassant, un autre et moi. Que nous voulait-il ? Enfin, il arrive et : « Messieurs, je n'ai pas voulu partir en voyage sans vous serrer la main. »
Carotte, supprimez carotte. Vous n'y tenez pas ! Carotte n'est pas un mot du grand monde...
Mendès, ce ruffian de lettres, un être malfaisant, cérébral. Toute sa littérature est cérébrale. Des plaisanteries, ses histoires de femmes ! Est impuissant, a de petites pustules sur les lèvres, et se soigne !... Met de petites pilules dans sa boisson, des pilules sans nom qui ont l'air d'être faites par lui... Très habile, et aime les lettres quand ça ne coûte rien. A joué Villiers, Moréas, a joué tout le monde, excepté Lorrain, qui lui tient tête.
Sarcey, ignoble. Lemaître, plus ignoble encore, parce qu'il croit comprendre. France, crétin. Maupassant a fait des affaires avec des terrains, a une maladie de la moelle...
Je voudrais être en prose un poëte mort qui se regrette.
La prose doit être un vers qui ne va pas à la ligne.
20 octobre.
Une salle de rédaction. Des cartons verts dont les lamentables lèvres pendent, des carreaux barbouillés comme exprès, des numéros du jour par terre, et des bouts de papier collés sur le mur avec des pains à cacheter, quelques-uns avec des crachats. Une atmosphère de lieux d'aisance où des collégiens fument. Sur la table, les Plaideurs de Racine. Tout autour, un grouillement, des coups de timbre. Dans la salle d'attente, une vieille femme, avec un vieux cabas, qui semble attendre qu'on lui apporte des épluchures d'articles.
22 octobre.
Mes amis m'attendent au roman, comme au détour d'une rue.
24 octobre.
Vu ce matin M. Paul Ollendorff. A la goutte. Est-ce pour ne pas se lever quand un visiteur entre ? Soulaine le chef des corrections d'épreuves, a sur le visage comme un reflet de Trézenik. Ollendorff m'a fait le discours connu sur le succès d'estime qui m'attend certainement, et ce succès d'argent qui m'attend aussi, mais avec moins impatience.
28 octobre.
Quand Schwob dit qu'une chose est très bien, son oeil a un petit papillotement comme des lèvres qui prient.
Être méchant sur le papier.
On peut donner le ton des paysans sans faute d'orthographe.
30 octobre.
Une phrase solide, comme construite avec des lettres d'enseigne en plomb découpé.
Je ne ris pas de la plaisanterie que vous faites, mais de celle que je vais faire.
2 novembre.
C'est étonnant comme toutes les célébrités littéraires gagnent à être vues en caricature !
Toujours cette timidité en entrant dans un bureau de rédaction. Des ennemis peut-être sont cachés dans les cartons, et, comme un gros monsieur aimable, correcteur des épreuves du Supplément, m'offre obligeamment une chaise, je me demande s'il se moque de moi, s'il veut me jouer un tour.
Hier, touché mon premier sou de lettres. A ce moment-là, un sou, c'est aussi beau que 50 000 francs.
En sortant, Schwob me dit : « Vous voyez cette femme qui me quitte ? C'est mon passé qui revient et que je vais reprendre. Cette femme-là m'a fait faire tout ce qui mène en correctionnelle et en Cour d'assises. Elle m'a, en outre, rendu ridicule, et moi, le Schwob que vous connaissez, j'ai été un monsieur montant à cheval, jouant aux courses, vêtu à la dernière mode. Je la méprise. Elle est bête Elle revient à moi parce qu'elle me croit de l'argent. Elle est orgueilleuse. Elle me considère comme un journaliste, et les journalistes comme rien, et cependant je vais la reprendre. Je vais peut-être faire souffrir, pour cette grue que je n'aime pas, une autre petite femme que j'aime, qui est simple, bonne, et se contente du peu que je lui donne. Ce n'est pourtant pas sa chair qui m'attire. Qu'est-ce que c'est ? Je vais redevenir ce que j'ai été : quelque chose de pas propre. »
Définition, à peu près du mot « terme » par Schwob : un dieu dont on célèbre la fête avec des cloches de bois.
4 novembre.
Dîner Flammarion. Gravement on nous enlève, à Schwob et à moi, des assiettes où nous n'avons pas mangé. La sole au vin blanc n'arrive pas jusqu'à nous. Nous faisons des provisions de pain et de pommes vertes. Des gens se battent pour du fromage. Un monsieur, un Clovis Hugues soufflé, fait le chien-loup et pousse des hurlements. Un auteur, que nous croyons dramatique, et qui est monologuiste, dit une chanson... Xanrof fait le stupide au piano. Fasquelle, l'associé de Charpentier, exécute la danse du ventre et, frottant son pouce contre la table, la fait trembler. Il a un large nez écrasé au milieu du visage. C'est comme un coup de pied qu'on lui aurait donné, et dont il lui serait resté le pied.
Mendès parle à Flammarion, et celui-ci a l'air aussi embêté qu'un éditeur qui écoute un auteur. Flammarion l'astronome, qui m'a tout de suite, en entrant, demandé la moitié de mon pain, me dit qu'il prépare la fin du monde : sept ans de travail. Il a l'air bien avec le Ciel et très bien avec lui-même. Un acteur, Florent, artiste, qui fait des imitations, est rasé comme une fesse, et cependant il a trouvé le moyen de se faire une raie. On voit au loin, au bout de la table, Ginisty dont les yeux sont comme des fentes de porte-plume pour mettre la plume. Il a les cheveux huileux, sortant de lessive, et, sur le front, quelque chose que Schwob prend pour une souris, et moi pour un derrière de crapaud. Un monsieur, qui a une tache lie de vin, ressemble à un assassin qui viendrait se mettre à table sans s'essuyer. Un autre, sorte d'Homère roussi et édenté, parle des souffles : c'est Lacroix, le monsieur qui a donné près d'un million à Victor Hugo. Bertol-Graivil, un pion maigre et décoré.
Schwob : « Quelles bestialités ! »
Moi : « Et ces cheveux qu'ils ont ! Comme si le bon Dieu, pressé, n'avait pas eu le temps de leur ôter ça. »
Schwob : « Et ces yeux, ces doubles molards, et ces nez, ces extraordinaires protubérances charnues ! »
Lui est beau, moi aussi, sans doute.
On se lève de table, et je vois Mendès qui se reculotte.
Allais : « Je suis heureux de connaître Jules Renard. »
Moi : « Moi, je vous connaissais. Vous avez fait un bien amusant livre. »
Allais : « Oh ! C'est un chef-d'oeuvre. »
Moi : « Je me rappelle, de vous, une histoire. Vous savez ? Cette petite fille qui ne veut pas monter dans un omnibus dont la couleur ne va pas avec sa toilette... »
Allais : « Parbleu ! Je vous crois. C'est un pur bijou. Mais Renard a l'air désolé. »
Moi : « Pas du tout. Je m'amuse, et mon rêve était de causer avec des hommes de lettres. »
Mendès : « Un jour, je suis allé dîner chez Cladel, et il s'amusait à mettre son gosse les fesses nues sur la soupière : ça lui chauffait le derrière. Ça faisait rire Cladel et nous donnait de l'appétit.
« Il est encore moins sale que Philoxène Boyer que j'ai vu vivre un mois avec une grande raie d'encre sur la joue droite, et, quand il ouvrait l'oeil, ça faisait une solution de continuité. »
Courteline : « Ça ne vaut pas ce monsieur qui ne voulait pas quitter sa paire de chaussettes sales. Il en mettait une paire de neuves, et les vieilles s'en allaient en passant au travers des neuves. J'ai vu aussi deux ivrognes saouls jouer aux cartes. L'un, en tournant le roi, dégueulait des tas de choses, entre autres des morceaux de rognons ; l'autre, saoul comme lui, faisait le pli, se levait et, prenant les morceaux de rognons qui pendaient dans la barbe de son ami, les mettait dans sa poche. »
7 novembre.
Visite à Barrès.
Barrès : « Devant les grandes douleurs, je suis toujours pris d'un fou rire. »
Moi : « Pourquoi n'organise-t-on pas un système d'agents qui feraient nos visites de condoléances ? Les pleureurs de l'Antiquité étaient bien imaginés. »
Byvanck : « Il ne faut aimer les femmes de lettres que mortes. »
Barrès : « Je n'aime que les articles des étrangers. Ce sont les seuls qui vous donnent l'illusion de la sincérité. »
Moi : « Je les aime parce que je ne les comprends pas, qu'on n'y voit que le nom, sans deviner ce qu'il y a autour, ce qui autorise toute liberté de traduction. »
Barrès : « Ce qui m'agace, c'est que toute femme que je rencontre me demande ce que je pense de l'amour. »
Byvanck : « Un écrivain allemand a prouvé que la pitié que nous feignons d'avoir pour le peuple n'est que la peur que nous avons de lui. »
Barrès : « Cependant, un chien écrasé... »
Moi : « Quand il est écrasé, bien ; mais avant ? »
Nous sommes allés nous purifier à la flamme modérée de Barrès.
La poignée de main plongeuse, en cou de cygne, de Barrès. Cette poignée de main n'est d'ailleurs qu'un vague attouchement de doigts.
Maurice Barrès en veston à longs poils, en bottines déboutonnées, dans un grand atelier de verre et de bois.
Barrès : « Oui, Stendhal commence à m'ennuyer, mais si j'en pense moins de bien, je ne veux pas qu'on en dise du mal devant moi »
8 novembre.
Très jeune, on a de l'originalité, mais pas de talent.
25 novembre.
J'ai fait le calcul : la littérature peut nourrir un pinson, un moineau.
30 novembre.
Barrès oublie souvent que ce qu'il appelle dédaigneusement « un récit » est plus difficile à faire qu'une réflexion philosophique.
Il y a des critiques qui ne parlent que des livres qu'on va faire.
1er décembre.
Comme c'est vain, une idée ! Sans la phrase, j'irais me coucher.
2 décembre.
Il est mauvais de vouloir plaire aux gens de talent. Quelle chose morte serait une littérature pour plaire à Barrès !
Les gens auxquels on trouve du talent et qu'on ne lit jamais.
Il conviendrait de mettre sur nos livres, au lieu de premier, deuxième mille : première douzaine, deuxième douzaine.
Cet homme a autant d'effets sur lui qu'un oignon de pelures.
3 décembre.
Tout cela est bien, mais quand irons-nous dans la lune ?
4 décembre.
Il était si laid que, lorsqu'il faisait des grimaces, il l'était moins.
7 décembre.
Il n'y a qu'une façon d'être un peu moins égoïste que les autres : c'est d'avouer son égoïsme.
11 décembre.
J'avoue très humblement mon orgueil.
12 décembre.
Quand on sort du Théâtre d'Art, on a envie d'appeler sa femme la bien-aimée de son âme et la bonne, fille de Jérusalem. Je trouve ça très dansant, le Cantique de Salomon. Théodat, qui est une chose de nuances, paraît gros, gros, et l'évêque a la grâce d'une paire de pincettes.
Vu Camille de Sainte-Croix, une belette, qui s'imaginait que j'étais un gros homme brun, à fortes moustaches, Octave Mirbeau, qui cherche des choses, le Stryienski de Stendhal, qui me remercie avec chaleur d'articles parus je ne sais où, et j'accepte de même ces remerciements qui ne sont pas à moi. On me parle beaucoup de mon roman qui va paraître, afin de ne m'en plus parler quand il aura paru.
14 décembre.
Au dîner du Gil Blas, Maizeroy, un type de garçon d'honneur, Jules Guérin, un type d'ancien viveur qui sourit à la manière des sceptiques, d'Hubert, un type de gentilhomme accablé et bébête. Séverine a des resserrements de tout son être quand elle parle des mères qui ont cinq enfants.
-- A Saint-Étienne, dit-elle, les couches du sol sont si minces que, souvent, les mineurs qui travaillent sous les cimetières reçoivent sur la tête la poussière des morts. Vous me faites songer à Vallès, et vous savez quel culte j'ai pour lui. Ne me croyez pas complimenteuse. Je ne fais jamais de compliments.
-- Il est entendu, dis-je, qu'on ne fait jamais de compliments.
-- Je me rappelle, de vous, un article sur Schwob. Vous l'avez tué de ridicule.
-- Qu'est-ce que vous me dites là !
-- Oui, il y a l'ange et le diable chez l'homme. Vous avez fait cet article comme un diable, et pas comme un bon diable.
Arrive Labruyère qui me dit la même chose ; seulement, en vrai rastaquouère, il prononce Schwoub au lieu de Schwob. Il a des cheveux raides, impénétrables, qui lui rabattent les oreilles et semblent sortir de chez un mauvais perruquier.
Léopold Lacour à Vandérem :
-- Je vous admire. Vous êtes calme et fort. Vous allez droit à votre but. Vous êtes partout, vous connaissez tout le monde, vous n'avez pas un ennemi, moi, j'ai dansé pendant douze ans sur les mains, dans les salons de Paris, et je ne suis arrivé à rien. Vous, vous êtes prudent, point sauteur, et vous arriverez à tout.
Vandérem, un Ajalbert distingué :
-- Dites tout de suite que je suis une fripouille !
Labruyère a son tabac dans une marmite. Quand il bourre sa pipe à tout petits coups de pouce, il parle de Séverine en termes folichons.
Talmeyr, un esprit fin, méchant, comme les gens qui ont un mauvais estomac. Il me peint les convives d'un mot sec.
-- Pauwels : une tête de cour d'assises. Il n'y passe point, parce qu'on croit peut-être qu'il y a déjà passé. Voici le plus gros actionnaire du Gil-Blas : il y a opposition sur ses titres.
On me présente. On me présente aussi au président du conseil d'administration, et tous ces vieux m'adressent des compliments sur mon histoire de cabinets bouchés. Peut-être que, pour réussir au Gil-Blas, il faut et il suffit de voir l'humanité en un endroit : le milieu, des deux côtes.
Massiac : une poupée de quarante-cinq ans, des gestes menus, une barbe énorme, des joues qui dépassent la barbe. On s'attend à le voir soudain poser sur la table sa barbe, ses joues et sa tête.
Bruant, l'homme aux bottes, au complet de velours, à la chemise rouge, une tête de belle vieille. Il hurle ses chansons les mains dans les poches, et donne parfois la sensation du génie, en enthousiasmant.
D'Esparbès montre ses mollets carrés, et durs, et rouges, comme des prix d'honneur.
Lacour se met à faire le paillasse, à se rouler par terre, pour arriver, sans doute. Des femmes sont assises sur des genoux, et des animaux vont surgir des hommes.
Armand d'Artois :
-- Comme je disais à Mendès : « Voyons ! Vous n'allez pas me faire croire que les décadents ont du talent, et que les choses que vous avez prises à Moréas pour L'Écho sont bien », Mendès m'a répondu : « Il ne faut pas qu'on les étouffe !... »
16 décembre.
Je note que Barrès n'entretient que les amis qui peuvent lui être utiles. Je lui ai présenté Schwob, je l'ai fait dîner avec Schwob, ici, et, comme Schwob est directeur du Supplément de L'Écho, la suite se devine,
Il est bien malheureux que notre goût avance quand notre talent ne bouge pas.
17 décembre.
En somme qu'est-ce que je dois à ma famille ? -- Ingrat ! Des romans tout faits.
21 décembre.
C'est une erreur commune de prendre pour des amis deux personnes qui se tutoient.
22 décembre.
Vu ce soir Armand Silvestre. Je n'ai entendu que ce mot qu'il disait au fils Simon :
-- J'ai l'oeil fixé sur vous.
Et il lui montrait son derrière.
23 décembre.
Vu hier Antoine pour la première fois au Théâtre Libre. Il ressemble au médecin de Barfleur. La Dupe d'Ancey.
-- Je trouve ça très bien, disait Roinard, parce que ça fait descendre un peu plus bas le naturalisme.
Selon moi, des mots d'auteur mal préparés, pas vrais, des types trop tranchés, un type de viveur qui est un voyou, des actrices qui remuent les poings comme des lapins. Enfin, des couplets, toujours des couplets.
-- J'ai été très content de ma soirée, en somme, dit Roinard. Le Cantique des Cantiques est une chose nouvelle. Avec Salomon derrière moi, je n'avais pas peur, mais avec tout autre je n'aurais pas osé faire ça. Ma machine des parfums qu'on a tant blaguée (blague de bon aloi !) m'est venue naturellement. Ça pue le parfum dans le Cantique. Seulement, il m'aurait fallu un calorifère, tout au moins un poêle, où ces parfums eussent pu cuire. Au lieu de ça, on m'a donné un monsieur avec un vaporisateur dans une loge. D'ailleurs, quelle soirée ! Tout le monde m'était hostile. Vous comprenez qu'on sentait là quelque chose de neuf. J'ai peint les décors moi- même : j'en suis de 500 francs de ma poche...
-- Quand vous auriez tant besoin de vous acheter un chapeau !
Son petit coeur. Encore Pierrot, Colombine, Arlequin et quel Arlequin ! Non ! Non ! Fermez ! La littérature est pleine.
Le petit éphèbe Marsolleau va d'ami en ami.
-- Est-ce pas ? C'est gentil. Et puis sans prétention est-ce pas ?
On parle, dans cette gentille pièce, de Zanetto, pour faire pst ! pst ! au succès du Passant.
M. et Mme Clovis Hugues s'installent au balcon. Aussitôt, un nom vient à mille bouches : Morin ! Morin ! C'est beau, la gloire !...
Touché du doigt la galantine d'Ajalbert, le hérissement de Rodenbach...
Vu, chez Schwob, André Gide, l'auteur des Cahiers d'André Walter. Schwob me présente comme un entêté insupportable.
-- Si vous ne l'êtes pas, dit Gide d'une voix grêle, vous en avez l'air.
C'est un imberbe, enrhumé du nez et de la gorge, mâchoires exagérées, yeux entre deux bourrelets. Il est amoureux d'Oscar Wilde, dont je vois la photographie sur la cheminée : un monsieur à la chair grasse, très distingué, imberbe aussi, qu'on a récemment découvert.
Impossible d'avoir Courteline à dîner. Il dîne tous les soirs dans sa famille.
-- Mais, dit Schwob, vous dînez tous les mardis avec Mendès, c'est encore ma famille, dit Courteline.
24 décembre.
Hier, dîné chez de Beauregard. Tout était froid, excepté un semi-vieux, Firmin Javel, qui avait connu Albert Glatigny et en parlait avec chaleur.
Aujourd'hui que je viens de toucher 215 francs au Gil Blas, je souris au comptable, aux caissiers, je suis exquis avec tout le monde. L'homme n'est pas la moitié d'un imbécile.
29 décembre.
Il faut pourtant se résigner à produire toujours l'effet contraire.
Monter à cheval sans étriers sur un serpent.
Année : 1892
Ajouter un commentaire