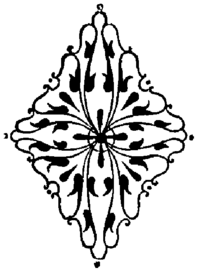- Accueil
- DISCOURS ACADEMIQUES
- Sully Prudhomme - Stances
Sully Prudhomme - Stances
Œuvres de Sully Prudhomme/Poésies 1865-1866
Œuvres de Sully Prudhomme, Alphonse Lemerre, Poésies 1865-1866 (p. np).
TABLE DES MATIERES
STANCES
- La Vie intérieure.
- Printemps oublié
- Les Chaînes
- Le Vase brisé
- L’Habitude
- Rosées
- Renaissance
- L’Imagination
- À l’hirondelle
- Les Berceaux
- Comme alors
- La Mémoire
- Ici-bas
- Pensée perdue
- Un Songe
- Intus
- Les Yeux
- Le Monde des Âmes
- L’Idéal
- La Poésie
- L’Âme
- La Forme
- La Malade
- Jeunes filles.
- À ma Soeur
- Le meilleur Moment des Amours
- Un Sérail Ma Fiancée
- Séparaion
- Les Adieux
- « Je ne dois plus »
- Ressemblance
- Il y a longtemps
- Jours lointains
- En deuil
- Sonnet
- Fleur sans Soleil
- Consolation
- Mal ensevelie
- « Qui peut dire »
Femmes.
- La Femme
- La Puberté
- Inconstance
- L’Abîme
- « Si j’étais Dieu »
- Devant un Portrait
- Les voici
- Jalousie
- « Si je pouvais »
- Sonnet
- Sonnet
- Sonnet
- Seul
- Les Vénus
- Sonnet
- Inconscience
- Rencontre
- Hermaphrodite
- Plus tard
Mélanges.
- Le Lever du soleil
- La Chanson de l’Air
- Pan
- Naissance de Vénus
- Pluie
- Soleil
- Silène
- Les Oiseaux
- Les Fleurs
- À Douarnenez en Bretagne
- Chanson de Mer
- Une Aurore
- La Falaise
- L’Océan
- La Pointe du Raz
- Le Long du quai
- La Néréide
- Les Ouvriers
- Le Galop
- Incantation
- Le Travail
- Mon Ciel
- À un Trappiste
- Sonnet
- Le Passé
- La Trace humaine
- L’Ombre
- Paysan
- Au Bal de l’Opéra
- Sursum
- À un désespéré
- Indépendance
- Sur un vieux Tableau
- Toujours
- En avant
- Sésame
À
Léon Bernard-Derosne
Mon cher ami,
Notre affection mutuelle a si parfaitement mêlé ma jeunesse à la tienne que tu reconnaîtras, je l’espère, tes propres sentiments dans mon livre. Si l’expression qu’ils y trouvent ne te satisfait pas toujours, au moins me sauras-tu gré, toi qui me connais à fond, d’avoir toujours été sincère. Je voudrais que cette liberté fût discrète et n’offensât aucune foi, mais le doute est violent comme toute angoisse, et la conviction n’est pas souple. J’ai dit tout ce qui m’est venu au cœur, sans plus de réserve qu’avec toi.
SULLY PRUDHOMME.
Au Lecteur
Quand je vous livre mon poème,
Mon cœur ne le reconnaît plus :
Le meilleur demeure en moi-même,
Mes vrais vers ne seront pas lus.
Comme autour des fleurs obsédées
Palpitent les papillons blancs,
Autour de mes chères idées
Se pressent de beaux vers tremblants ;
Aussitôt que ma main les touche
Je les vois fuir et voltiger,
N’y laissant que le fard léger
De leur aile frêle et farouche.
Je ne sais pas m’emparer d’eux
Sans effacer leur éclat tendre,
Ni, sans les tuer, les étendre,
Une épingle au cœur, deux à deux.
Ainsi nos âmes restent pleines
De vers sentis mais ignorés ;
Vous ne voyez pas ces phalènes,
Mais nos doigts qu’ils ont colorés.
STANCES
La
Vie intérieure
Printemps oublié
Ce beau printemps qui vient de naître,
À peine goûté va finir ;
Nul de nous n’en fera connaître
La grâce aux peuples à venir.
Nous n’osons plus parler des roses :
Quand nous les chantons, on en rit ;
Car des plus adorables choses
Le culte est si vieux qu’il périt.
Les premiers amants de la terre
Ont célébré Mai sans retour,
Et les derniers doivent se taire,
Plus nouveaux que leur propre amour.
Rien de cette saison fragile
Ne sera sauvé dans nos vers,
Et les cytises de Virgile
Ont embaumé tout l’univers.
Ah ! frustrés par les anciens hommes,
Nous sentons le regret jaloux
Qu’ils aient été ce que nous sommes,
Qu’ils aient eu nos cœurs avant nous.
Les Chaînes
J’ai voulu tout aimer, et je suis malheureux,
Car j’ai de mes tourments multiplié les causes ;
D’innombrables liens frêles et douloureux
Dans l’univers entier vont de mon âme aux choses.
Tout m’attire à la fois et d’un attrait pareil :
Le vrai par ses lueurs, l’inconnu par ses voiles ;
Un trait d’or frémissant joint mon cœur au soleil,
Et de longs fils soyeux l’unissent aux étoiles.
La cadence m’enchaîne à l’air mélodieux,
La douceur du velours aux roses que je touche ;
D’un sourire j’ai fait la chaîne de mes yeux,
Et j’ai fait d’un baiser la chaîne de ma bouche.
Ma vie est suspendue à ces fragiles nœuds,
Et je suis le captif des mille êtres que j’aime :
Au moindre ébranlement qu’un souffle cause en eux
Je sens un peu de moi s’arracher de moi-même.
Le Vase brisé
À Albert Decrais
Le vase où meurt cette verveine
D’un coup d’éventail fut fêlé ;
Le coup dut effleurer à peine :
Aucun bruit ne l’a révélé.
Mais la légère meurtrissure,
Mordant le cristal chaque jour,
D’une marche invisible et sûre
En a fait lentement le tour.
Son eau fraîche a fui goutte à goutte,
Le suc des fleurs s’est épuisé ;
Personne encore ne s’en doute ;
N’y touchez pas, il est brisé.
Souvent aussi la main qu’on aime,
Effleurant le cœur, le meurtrit ;
Puis le cœur se fend de lui-même,
La fleur de son amour périt ;
Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde ;
Il est brisé, n’y touchez pas.
L’Habitude
L’habitude est une étrangère
Qui supplante en nous la raison :
C’est une ancienne ménagère
Qui s’installe dans la maison.
Elle est discrète, humble, fidèle,
Familière avec tous les coins ;
On ne s’occupe jamais d’elle,
Car elle a d’invisibles soins :
Elle conduit les pieds de l’homme,
Sait le chemin qu’il eût choisi,
Connaît son but sans qu’il le nomme,
Et lui dit tout bas : « Par ici. »
Travaillant pour nous en silence,
D’un geste sûr, toujours pareil,
Elle a l’œil de la vigilance,
Les lèvres douces du sommeil.
Mais imprudent qui s’abandonne
À son joug une fois porté !
Cette vieille au pas monotone
Endort la jeune liberté ;
Et tous ceux que sa force obscure
A gagnés insensiblement
Sont des hommes par la figure,
Des choses par le mouvement.
Rosées
À Paul Bouvard
Je rêve, et la pâle rosée
Dans les plaines perle sans bruit,
Sur le duvet des fleurs posée
Par la main fraîche de la nuit.
D’où viennent ces tremblantes gouttes ?
Il ne pleut pas, le temps est clair ;
C’est qu’avant de se former, toutes,
Elles étaient déjà dans l’air.
D’où viennent mes pleurs ? Toute flamme,
Ce soir, est douce au fond des cieux ;
C’est que je les avais dans l’âme
Avant de les sentir aux yeux.
On a dans l’âme une tendresse
Où tremblent toutes les douleurs,
Et c’est parfois une caresse
Qui trouble, et fait germer les pleurs.
Renaissance
Je voudrais, les prunelles closes,
Oublier, renaître, et jouir
De la nouveauté, fleur des choses,
Que l’âge fait évanouir.
Je resalurais la lumière,
Mais je déplîrais lentement
Mon âme vierge et ma paupière
Pour savourer l’étonnement ;
Et je devinerais moi-même
Les secrets que nous apprenons ;
J’irais seul aux êtres que j’aime
Et je leur donnerais des noms;
Émerveillé des bleus abîmes
Où le vrai Dieu semble endormi,
Je cacherais mes pleurs sublimes
Dans des vers sonnant l’infini ;
Et pour toi, mon premier poème,
Ô mon aimée, ô ma douleur,
Je briserais d’un cri suprême
Un vers frêle comme une fleur.
Si pour nous il existe un monde
Où s’enchaînent de meilleurs jours,
Que sa face ne soit pas ronde,
Mais s’étende toujours, toujours…
Et que la beauté, désapprise
Par un continuel oubli,
Par une incessante surprise
Nous fasse un bonheur accompli.
L’Imagination
J’imagine ! Ainsi je puis faire
Un ange sous mon front mortel !
Et qui peut dire en quoi diffère
L’être imaginé du réel ?
O mon intime Galatée,
Qui fais vivre en moi mon amour,
Par quelle terre es-tu portée ?
De quel soleil prends-tu le jour ?
L’air calme autour de moi repose,
Et cependant j’entends ta voix,
Je te baise, la bouche close,
Et, les yeux fermés, je te vois.
De quelle impalpable substance
Dans mon âme te formes-tu,
Toi qui n’as pas la consistance
D’une bulle au bout d’un fétu ?
Forme pâle et surnaturelle,
Quel désir intense faut-il
Pour que la trempe corporelle
Fixe ton élément subtil ?
Pour que ta beauté sorte et passe
Du ciel idéal au soleil,
Parmi les choses de l’espace
Qui subsistent dans mon sommeil ?
Tu n’es jamais consolidée
Comme les formes du dehors…
Bien heureux les fous dont l’idée
Prend le solide éclat des corps !
Dans l’air ils font passer leurs songes
Par une fixe et sombre foi ;
Leurs yeux mêmes croient leurs mensonges :
Ils sont plus créateurs que moi !
À l’Hirondelle
Toi qui peux monter solitaire
Au ciel, sans gravir les sommets,
Et dans les vallons de la terre
Descendre sans tomber jamais ;
Toi qui, sans te pencher au fleuve
Où nous ne puisons qu’à genoux,
Peux aller boire avant qu’il pleuve
Au nuage trop haut pour nous ;
Toi qui pars au déclin des roses
Et reviens au nid printanier,
Fidèle aux deux meilleures choses,
L’indépendance et le foyer ;
Comme toi mon âme s’élève
Et tout à coup rase le sol,
Et suit avec l’aile du rêve
Les beaux méandres de ton vol.
S’il lui faut aussi des voyages,
Il lui faut son nid chaque jour ;
Elle a tes deux besoins sauvages :
Libre vie, immuable amour.
Les Berceaux
Après le départ des oiseaux,
Les nids abandonnés pourrissent.
Que sont devenus nos berceaux ?
De leur bois les vers se nourrissent.
Le mien traîne au fond des greniers,
L’oubli morne et lent le dévore ;
Je l’embrasserais volontiers,
Car mon enfance y rit encore.
C’est là que j’avais nuit et jour,
Pour ciel de lit, des yeux de mère
Où mon âme épelait l’amour
Et ma prunelle la lumière.
Sur le cœur d’amis sûrs et bons,
Femmes sans tache, sur le vôtre,
C’est un berceau que nous rêvons
Sous une forme ou sous une autre.
Cet instinct de vivre blottis
Dure encore à l’âge où nous sommes ;
Pourquoi donc, si tôt trop petits,
Berceaux, trahissez-vous les hommes ?
Comme alors
Quand j’étais tout enfant, ma bouche
Ignorait un langage appris :
Du fond de mon étroite couche
J’appelais les soins par des cris ;
Ma peine était la peur cruelle
De perdre un jouet dans mes draps,
Et ma convoitise était celle
Qui supplie en tendant les bras.
Maintenant que sans être aidées
Mes lèvres parlent couramment,
J’ai moins de signes que d’idées :
On a changé mon bégaiement.
Et maintenant que les caresses
Ne me bercent plus quand je dors,
J’ai d’inexprimables tendresses,
Et je tends les bras comme alors.
La Mémoire
I
Ô Mémoire, qui joins à l’heure
La chaîne des temps révolus,
Je t’admire, étrange demeure
Des formes qui n’existent plus !
En vain tombèrent les grands hommes
Aux fronts pensifs ou belliqueux :
Ils se lèvent quand tu les nommes,
Et nous conversons avec eux ;
Et si tu permets ce colloque
Avec les plus altiers esprits,
Tu permets aussi qu’on évoque
Les cœurs humbles qu’on a chéris.
Le présent n’est qu’un feu de joie
Qui s’écroule à peine amassé,
Mais tu peux faire qu’il flamboie
Des mille fêtes du passé ;
Le présent n’est qu’un cri d’angoisse
Qui s’éteint à peine poussé,
Mais tu peux faire qu’il s’accroisse
De tous les sanglots du passé ;
L’être des morts n’est plus visible,
Mais tu donnes au trépassé
Une vie incompréhensible,
Présent que tu fais d’un passé !
Quelle existence ai-je rendue
A mon père en me souvenant ?
Quelle est donc en moi l’étendue
Où s’agite ce revenant ?
Un sort différent nous sépare :
Comment peux-tu nous réunir,
A travers le mur qui nous barre
Le passé comme l’avenir ?
Qui des deux force la barrière ?
Me rejoint-il, ou vais-je à lui ?
Je ne peux pas vivre en arrière,
Il ne peut revivre aujourd’hui !
II
Ô souvenir, l’âme renonce,
Effrayée, à te concevoir ;
Mais, jusqu’où ton regard s’enfonce,
Au chaos des ans j’irai voir ;
Parmi les gisantes ruines,
Les bibles au feuillet noirci,
Je m’instruirai des origines,
Des pas que j’ai faits jusqu’ici.
Devant moi la vie inquiète
Marche en levant sa lampe d’or,
Et j’avance en tournant la tête
Le long d’un sombre corridor.
D’où vient cette folle ? où va-t-elle ?
Son tremblant et pâle flambeau
N’éclaire ma route éternelle
Que du berceau vide au tombeau.
Mais j’étais autrefois ! Mon être
Ne peut commencer ni finir.
Ce que j’étais avant de naître,
N’en sais-tu rien, ô souvenir ?
Rassemble bien toutes tes forces
Et demande aux âges confus
Combien j’ai dépouillé d’écorces
Et combien de soleils j’ai vus !
Ah, tu t’obstines à te taire !
Ton œil rêveur, clos à demi,
Ne suit point par delà la terre
Ma racine dans l’infini.
Cherchant en vain mes destinées,
Mon origine qui me fuit,
De la chaîne de mes années
Je sens les deux bouts dans la nuit.
L’histoire, passante oublieuse,
Ne m’a pas appris d’où je sors,
Et la terre silencieuse
N’a jamais dit où vont les morts.
Ici-bas
Ici-bas tous les lilas meurent,
Tous les chants des oiseaux sont courts ;
Je rêve aux étés qui demeurent
Toujours…
Ici-bas les lèvres effleurent
Sans rien laisser de leur velours ;
Je rêve aux baisers qui demeurent
Toujours…
Ici-bas tous les hommes pleurent
Leurs amitiés ou leurs amours ;
Je rêve aux couples qui demeurent
Toujours…
Pensée perdue
Elle est si douce la pensée
Qu’il faut, pour en sentir l’attrait,
D’une vision commencée
S’éveiller tout à coup distrait.
Le cœur dépouillé la réclame ;
Il ne la fait point revenir,
Et cependant elle est dans l’âme,
Et l’on mourrait pour la finir.
A quoi pensais-je tout à l’heure ?
A quel beau songe évanoui
Dois-je les larmes que je pleure ?
Il m’a laissé tout ébloui.
Et ce bonheur d’une seconde,
Nul effort ne me l’a rendu ;
Je n’ai goûté de joie au monde
Qu’en rêve, et mon rêve est perdu.
Un Songe
À Jules Guiffrey
J’étais mort, j’entrais au tombeau
Où mes aïeux rêvent ensemble.
Ils ont dit : « La nuit lourde tremble ;
Est-ce l’approche d’un flambeau ?
« Le signal de la nouvelle ère
Qu’attend notre éternel ennui ?
— Non, c’est l’enfant, a dit mon père :
Je vous avais parlé de lui.
« Il était au berceau ; j’ignore
S’il nous vient jeune ou chargé d’ans.
Mes cheveux sont tout blonds encore,
Les tiens, mon fils, peut-être blancs ?
« — Non, père, au combat de la vie
Bientôt je suis tombé vaincu,
L’âme pourtant inassouvie :
Je meurs et je n’ai pas vécu.
« — J’attendais près de moi ta mère :
Je l’entends gémir au-dessus !
Ses pleurs ont tant mouillé la pierre
Que mes lèvres les ont reçus.
« Nous fûmes unis peu d’années
Après de bien longues amours ;
Toutes ses grâces sont fanées…
Je la reconnaîtrai toujours.
« Ma fille a connu mon visage :
S’en souvient-elle ? Elle a changé.
Parle-moi de son mariage
Et des petits-enfants que j’ai.
« — Un seul vous est né. — Mais toi-même,
N’as-tu pas de famille aussi ?
Quand on meurt jeune, c’est qu’on aime :
Qui vas-tu regretter ici ?
« — J’ai laissé ma sœur et ma mère
Et les beaux livres que j’ai lus ;
Vous n’avez pas de bru, mon père ;
On m’a blessé, je n’aime plus.
« — De tes aïeux compte le nombre :
Va baiser leurs fronts inconnus,
Et viens faire ton lit dans l’ombre
A côté des derniers venus.
« Ne pleure pas ; dors dans l’argile
En espérant le grand réveil.
— Ô père, qu’il est difficile
De ne plus penser au soleil ! »
Intus
Deux voix s’élèvent tour à tour
Des profondeurs troubles de l’âme :
La raison blasphème, et l’amour
Rêve un dieu juste et le proclame.
Panthéiste, athée ou chrétien,
Tu connais leurs luttes obscures ;
C’est mon martyre, et c’est le tien,
De vivre avec ces deux murmures.
L’intelligence dit au cœur :
« Le monde n’a pas un bon père.
Vois, le mal est partout vainqueur. »
Le cœur dit : « Je crois et j’espère.
« Espère, ô ma sœur, crois un peu :
C’est à force d’aimer qu’on trouve ;
Je suis immortel, je sens Dieu. »
— L’intelligence lui dit : « Prouve ! »
Les Yeux
A Francisque Gerbault
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore ;
Ils dorment au fond des tombeaux,
Et le soleil se lève encore.
Les nuits, plus douces que les jours,
Ont enchanté des yeux sans nombre ;
Les étoiles brillent toujours,
Et les yeux se sont remplis d’ombre.
Oh ! qu’ils aient perdu le regard,
Non, non, cela n’est pas possible !
Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu’on nomme l’invisible ;
Et comme les astres penchants
Nous quittent, mais au ciel demeurent,
Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent.
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient encore.
Le Monde des Âmes
À R. Albaret
Newton, voyant tomber la pomme,
Conçut la matière et ses lois :
Oh ! surgira-t-il une fois
Un Newton pour l’âme de l’homme ?
Comme il est dans l’infini bleu
Un centre où les poids se suspendent,
Ainsi toutes les âmes tendent
A leur centre unique, à leur Dieu.
Et comme les sphères de flammes
Tournent en s’appelant toujours,
Ainsi d’harmonieun amours
Font graviter toutes les âmes.
Mais le baiser n’est pas permis
Aux sphères à jamais lancées ;
Les lèvres, les regards amis
Joignent les âmes fiancées !
Qui sondera cet univers
Et l’attrait puissant qui le mène ?
Viens, ô Newton de l’âme humaine,
Et tous les cieux seront ouverts !
L’Idéal
À Paul Sédille
La lune est grande, le ciel clair
Et plein d’astres, la terre est blême,
Et l’âme du monde est dans l’air.
Je rêve à l’étoile suprême,
À celle qu’on n’aperçoit pas,
Mais dont la lumière voyage
Et doit venir jusqu’ici-bas
Enchanter les yeux d’un autre âge.
Quand luira cette étoile, un jour,
La plus belle et la plus lointaine,
Dites-lui qu’elle eut mon amour,
Ô derniers de la race humaine !
La Poésie
À Victor Géruzez
Quand j’entends disputer les hommes
Sur Dieu qu’ils ne pénètrent point,
Je me demande où nous en sommes :
Hélas ! toujours au même point.
Oui, j’entends d’admirables phrases,
Des sons par la bouche ennoblis ;
Mais les mots ressemblent aux vases :
Les plus beaux sont les moins remplis.
Alors, pour me sauver du doute,
J’ouvre un Euclide avec amour ;
Il propose, il prouve, et j’écoute,
Et je suis inondé de jour.
L’évidence, éclair de l’étude,
Jaillit, et me laisse enchanté !
Je savoure la certitude,
Mon seul vrai bonheur, ma santé !
Pareil à l’antique sorcière
Qui met, par le linéament
Qu’elle a tracé dans la poussière,
Un monde obscur en mouvement,
Je forme un triangle : ô merveille !
Le peuple des lois endormi
S’agite avec lenteur, s’éveille
Et se déroule à l’infini.
Avec trois lignes sur le sable
Je connais, je ne doute plus !
Un triangle est donc préférable
Aux mots sonores que j’ai lus ?
Non ! j’ai foi dans la Poésie :
Elle instruit par témérité ;
Elle allume sa fantaisie
Dans tes beaux yeux, ô Vérité !
Si le doigt des preuves détache
Ton voile aux plis multipliés,
Le vent des strophes te l’arrache,
D’un seul coup, de la tête aux pieds.
Et c’est pourquoi, toute ma vie,
Si j’étais poète vraiment,
Je regarderais sans envie
Képler toiser le firmament !
L’Âme
À Alphonse Thévenin
J’ai dans mon cœur, j’ai sous mon front
Une âme invisible et présente :
Ceux qui doutent la chercheront ;
Je la répands pour qu’on la sente.
Partout scintillent les couleurs,
Mais d’où vient cette force en elles ?
Il existe un bleu dont je meurs,
Parce qu’il est dans les prunelles.
Tous les corps offrent des contours,
Mais d’où vient la forme qui touche ?
Comment fais-tu les grands amours,
Petite ligne de la bouche ?
Partout l’air vibre et rend des sons,
Mais d’où vient le délice intime
Que nous apportent ses frissons
Quand c’est une voix qui l’anime ?
J’ai dans mon cœur, j’ai sous mon front
Une âme invisible et présente :
Ceux qui doutent la chercheront ;
Je la répands pour qu’on la sente.
La Forme
À Maurice de Foucault
Le soleil fut avant les yeux,
La terre fut avant les roses,
Le chaos avant toutes choses.
Ah ! que les éléments sont vieux
Sous leurs jeunes métamorphoses !
Toute jeunesse vient des morts :
C’est dans une funèbre pâte
Que, toujours, sans lenteur ni hâte,
Une main pétrit les beaux corps
Tandis qu’une autre main les gâte ;
Et le fond demeure pareil :
Que l’univers s’agite ou dorme,
Rien n’altère sa masse énorme ;
Ce qui périt, fleur ou soleil,
N’en est que la changeante forme.
Mais la forme, c’est le printemps :
Seule mouvante et seule belle,
Il n’est de nouveauté qu’en elle ;
C’est par les formes de vingt ans
Que rit la matière éternelle !
Ô vous, qui tenez enlacés
Les amoureux aux amoureuses,
Bras lisses, lèvres savoureuses,
Formes divines qui passez,
Désirables et douloureuses !
Vous ne laissez qu’un souvenir,
Un songe, une impalpable trace !
Si fortement qu’il vous embrasse,
L’Amour ne peut vous retenir :
Vous émigrez de race en race.
Époux des âmes, corps chéris,
Vous vous poussez, pareils aux fleuves ;
Vos grâces ne sont qu’un jour neuves,
Et les âmes sur vos débris
Gémissent, immortelles veuves.
Mais pourquoi vous donner ces pleurs ?
Les tombes, les saisons chagrines,
Entassent en vain des ruines
Sans briser le moule des fleurs,
Des fruits et des jeunes poitrines.
Pourquoi vous faire des adieux ?
Le même sang change d’artères,
Les filles ont les yeux des mères,
Et les fils le front des aïeux.
Non, vous n’êtes pas éphémères !
Vos modèles sont quelque part,
Ô formes que le temps dévore !
Plus pures vous brillez encore
Au paradis profond de l’art,
Où Platon pense et vous adore !
La Malade
À Alfred Denaut
C’était au milieu de la nuit,
Une longue nuit de décembre ;
Le feu, qui s’éteignait sans bruit,
Rougissait par moments la chambre.
On distinguait des rideaux blancs,
Mais on n’entendait pas d’haleine ;
La veilleuse aux rayons tremblants
Languissait dans la porcelaine.
Et personne, hélas ! ne savait
Que l’enfant fût à l’agonie ;
De lassitude, à son chevet,
Sa mère s’était endormie.
Mais, pour la voir, tout bas, pieds nus,
Entr’ouvrant doucement la porte,
Ses petits frères sont venus…
Déjà la malade était morte.
Ils ont dit : « Est-ce qu’elle dort ?
Ses yeux sont fixes ; de sa bouche
Nul murmure animé ne sort ;
Sa main fait froid quand on la touché.
« Quel grand silence dans le lit !
Pas un pli des draps ne remue ;
L’alcôve effrayante s’emplit
D’une solitude inconnue.
« Notre mère est assise là ;
Elle est tranquille, elle sommeille :
Qu’allons-nous faire ? Laissons-la.
Que Dieu lui-même la réveille ! »
Et, sans regarder derrière eux,
Vite dans leurs lits ils rentrèrent :
Alors, se sentant malheureux,
Avec épouvante ils pleurèrent.
JEUNES FILLES
Jeunes Filles
À ma Sœur
Ces vers que toi seule aurais lus,
L’œil des indifférents les tente ;
Sans gagner un ami de plus
J’ai donc trahi ma confidente.
Enfant, je t’ai dit qui j’aimais,
Tu sais le nom de la première ;
Sa grâce ne mourra jamais
Dans mes yeux qu’avec la lumière.
Ah ! si les jeunes gens sont fous,
Leur enthousiasme s’expie ;
On se meurtrit bien les genoux
Quand on veut saluer la vie.
J’ai cru dissiper cet amour ;
Voici qu’il retombe en rosée,
Et je sens son muet retour
Où chaque larme s’est posée.
Le meilleur Moment
des Amours
Le meilleur moment des amours
N’est pas quand on a dit : « Je t’aime. »
Il est dans le silence même
À demi rompu tous les jours ;
Il est dans les intelligences
Promptes et furtives des cœurs ;
Il est dans les feintes rigueurs
Et les secrètes indulgences ;
Il est dans le frisson du bras
Où se pose la main qui tremble,
Dans la page qu’on tourne ensemble
Et que pourtant on ne lit pas.
Heure unique où la bouche close
Par sa pudeur seule en dit tant ;
Où le cœur s’ouvre en éclatant
Tout bas, comme un bouton de rose ;
Où le parfum seul des cheveux
Paraît une faveur conquise !
Heure de la tendresse exquise,
Où les respects sont des aveux !
Un Sérail
J’ai mon sérail comme un prince d’Asie,
Riche en beautés pour un immense amour ;
Je leur souris selon ma fantaisie :
J’aime éternellement la dernière choisie,
Et je les choisis tour à tour.
Ce ne sont pas ces esclaves traîtresses
Que l’Orient berce dans la langueur ;
Ce ne sont pas de vénales maîtresses :
C’est un vierge harem d’amantes sans caresses,
Car mon harem est dans mon cœur.
N’y cherchez point les boîtes parfumées,
Ni la guitare aux soupirs frémissants ;
Chants et parfums ne sont qu’air et fumées :
C’est ma jeunesse même, ô douces bien-aimées,
Que je vous brûle pour encens !
Les gardiens noirs que le soupçon dévore
Selon mes vœux ne vous cacheraient pas ;
Ma jalousie est plus farouche encore :
Elle est toute en mon âme, et le vent même ignore
Les noms que je lui dis tout bas.
Ma Fiancée
L’épouse, la compagne à mon cœur destinée,
Promise à mon jeune tourment,
Je ne la connais pas, mais je sais qu’elle est née ;
Elle respire en ce moment.
Son âge et ses devoirs lui font la vie étroite ;
Sa chambre est un frais petit coin ;
Elle y prend sa leçon, bien soumise et bien droite,
Et sa mère n’est jamais loin.
Ma mère, parlez-lui du bon Dieu, de la Vierge
Et des saints tant qu’il lui plaira ;
Oui, rendez-la timide et qu’elle brûle un cierge
Quand le tonnerre grondera.
Je veux, entendez-vous, qu’elle soit grave et tendre,
Qu’elle chérisse et qu’elle ait peur ;
Je veux que tout mon sang me serve à la défendre,
À la caresser tout mon cœur.
Déjà dans l’inconnu je t’épouse et je t’aime,
Tu m’appartiens dès le passe,
Fiancée invisible et dont j’ignore même
Le nom sans cesse prononcé.
A défaut de mes yeux, mon rêve te regarde,
Je te soigne et te sers tout bas :
« Que veux-tu ? Le voici. Couvre-toi bien, prends garde
Au vent du soir, et ne sors pas. »
Pour te sentir à moi je fais un peu le maître,
Et je te gronde avec amour ;
Mais j’essuie aussitôt les pleurs que j’ai fait naître,
Implorant ma grâce à mon tour.
Tu t’assiéras, l’été, bien loin, dans la campagne,
En robe claire, au bord de l’eau.
Qu’il est bon d’emporter sa nouvelle compagne
Tout seul dans un pays nouveau !
Et dire que ma vie est cependant déserte,
Que mon bonheur peut aujourd’hui
Passer tout près de moi dans la foule entr’ouverte
Qui se refermera sur lui,
Et que déjà peut-être elle m’est apparue,
Et j’ai dit : « La jolie enfant ! »
Peut-être suivons-nous toujours la même rue,
Elle derrière et moi devant.
Nous pourrons nous croiser en un point de l’espace,
Sans nous sourire, bien longtemps,
Puisqu’on n’oserait dire à la vierge qui passe :
« Vous êtes celle que j’attends. »
Un jour, mais je sais trop ce que l’épreuve en coûte,
J’ai cru la voir sur mon chemin,
Et j’ai dit : « C’est bien vous. » Je me trompais sans doute,
Car elle a retiré sa main.
Depuis lors, je me tais ; mon âme solitaire
Confie au Dieu qui sait unir
Par les souffles du ciel les plantes sur la terre
Notre union dans l’avenir,
À moins que, me privant de la jamais connaître,
La mort déjà n’ait emporté
Ma femme encore enfant, toi qui naissais pour l’être
Et ne l’auras jamais été.
Séparation
Je ne devais pas vous le dire ;
Mes pleurs, plus forts que la vertu,
Mouillant mon douloureux sourire,
Sont allés sur vos mains écrire
L’aveu brûlant que j’avais tu.
Danser, babiller, rire ensemble,
Ces jeux ne nous sont plus permis :
Vous rougissez, et moi je tremble ;
Je ne sais ce qui nous rassemble.
Mais nous ne sommes plus amis.
Disposez de nous, voici l’heure
Où je ne puis vous parler bas
Sans que l’amitié change ou meure :
Oh ! dites-moi qu’elle demeure,
Je sens qu’elle ne suffit pas.
Si le langage involontaire
De mes larmes vous a déplu,
Eh bien, suivons chacun sur terre
Notre sentier : moi, solitaire,
Vous, heureuse, au bras de l’élu.
Je voyais nos deux cœurs éclore
Comme un couple d’oiseaux chantants
Éveillés par la même aurore ;
Ils n’ont pas pris leur vol encore :
Séparons-les, il en est temps ;
Séparons-les à leur naissance,
De crainte qu’un jour à venir,
Malheureux d’une longue absence,
Ils n’aillent dans le vide immense
Se chercher sans pouvoir s’unir.
Les Adieux
Les jeunes filles
Amis, amis, nous voilà grandes ;
Nos jours ont changé de saison.
Allez préparer vos offrandes,
Allez suspendre les guirlandes
À la porte de la maison.
Elle a sonné, l’heure fatale
Qu’on tremblait de voir approcher ;
Des fleurs que la prairie étale
Semez la route triomphale
Où l’hymen en blanc va marcher.
Les jeunes gens
Quelle solitude est la nôtre !
Ou dans les bras de l’homme, ou dans les bras de Dieu,
Nos compagnes, hélas ! tombent l’une après l’autre.
Adieu !…
Un soir s’en va l’enfant aimée :
Sa vie en s’éteignant nous laisse un corps tout froid,
Comme d’un cierge pur la flamme parfumée
Décroît…
Un matin c’est une épousée :
Elle marche à l’autel, l’œil baissé mais vainqueur ;
Aux lèvres va fleurir la joie ensemencée
Au cœur !
Qui êtes-vous, vierges de la veille ?
Ange ? épouse ? pour vous quel est le meilleur sort ?
Plus d’une ombre en passant nous répond à l’oreille :
« La mort… »
Les jeunes filles
Pourquoi cette parole amère ?
Pourquoi ces pleurs dans vos adieux ?
La fille imite enfin sa mère ;
Mais l’amitié reste sincère,
Bien qu’elle ait dû baisser les yeux.
Cherchez autour de vous laquelle
N’a pas reçu son maître un jour.
Le cœur se fixe où Dieu l’appelle ;
Mais l’amitié reste fidèle,
Bien que le cœur ait un amour.
Les jeunes gens
Ah ! vous nous oublierez avant demain sans doute !
Vierges, notre jeunesse est la rosée au vent :
Elle tombe avec vous de nos cœurs goutte à goutte ;
Une seule en partant peut nous l’emporter toute
Et n’en sait rien souvent.
Hélas ! où voulez-vous que nous posions nos âmes,
Si vous changez de ciel, ô fleurs de la maison ?
Que peuvent les vieillards, dispensateurs des blâmes,
Qui versent à toute heure et sur toutes nos flammes
Comme une neige la raison ?
Que peuvent nos amis, ceux que l’orgie entraîne,
De nos soupirs cachés insouciants moqueurs ?
Ou ceux qui, délaissés, ressentent notre peine ?
Que peuvent-ils pour nous ? La gloire serait vaine
À vous supplanter dans nos cœurs !
Les jeunes filles
Chacune de nous est l’aînée
De sœurs qui la supplanteront ;
Notre fleur d’oranger ne sera pas fanée
Avant que leur seizième année
Nous la demande pour leur front.
Leurs jeux nous font encore envie,
Ils vont nous être défendus ;
À de graves devoirs doucement asservie,
S’éloigne de vous notre vie ;
Peut-être ne rirons-nous plus…
Les jeunes gens
Puisque l’âge est passé des gaîtés familières,
Que la pudeur craintive a touché vos paupières
Et qu’on vous prend la main pour l’offrir à l’époux,
Puisque l’âge est passé des gaîtés familières,
Mariez-vous.
Puisque Dieu lentement disperse les familles,
Ravit aux jeunes gens l’amour des jeunes filles,
Et nous laisse gémir dans un ennui jaloux,
Puisque Dieu lentement disperse les familles,
Mariez-vous.
Nous sommes des enfants, on vous promet des hommes,
D’un prospère foyer protecteurs économes,
Peut-être moins aimants, mais plus sages que nous ;
Nous sommes des enfants, on vous promet des hommes :
Mariez-vous.
Les jeunes filles
Amis, votre âme n’est que tendre ;
Rendez-la forte pour attendre,
Pensez beaucoup et rêvez moins ;
La vierge ne peut vous entendre,
Portez à la vertu vos soins.
Vouez à quelque objet suprême
Un feu plus grand que l’amour même ;
Luttez pour devenir plus tôt
Des fiancés comme on les aime
Et des hommes comme il en faut.
Je ne dois plus
Je ne dois plus la voir jamais,
Mais je vais voir souvent sa mère ;
C’est ma joie, et c’est la dernière,
De respirer où je l’aimais.
Je goûte un peu de sa présence
Dans l’air que sa voix ébranla ;
Il me semble que parler là,
C’est parler d’elle à qui je pense.
Nulle autre chose que ses traits
N’y fixait mon regard avide ;
Mais, depuis que sa chambre est vide,
Que de trésors j’y baiserais !
Le miroir, le livre, l’aiguille,
Et le bénitier près du lit…
Un sommeil léger te remplit,
Ô chambre de la jeune fille !
Quand je regarde bien ces lieux,
Nous y sommes encore ensemble ;
Sa mère parfois lui ressemble
À m’arracher les pleurs des yeux.
Peut-être la croyez-vous morte ?
Non. Le jour où j’ai pris son deuil,
Je n’ai vu de loin ni cercueil
Ni drap tendu devant sa porte.
Ressemblance
Vous désirez savoir de moi
D’où me vient pour vous ma tendresse ;
Je vous aime, voici pourquoi :
Vous ressemblez à ma jeunesse.
Vos yeux noirs sont mouillés souvent
Par l’espérance et la tristesse,
Et vous allez toujours rêvant :
Vous ressemblez à ma jeunesse.
Votre tête est de marbre pur,
Faite pour le ciel de la Grèce
Où la blancheur luit dans l’azur :
Vous ressemblez a ma jeunesse.
Je vous tends chaque jour la main,
Vous offrant l’amour qui m’oppresse ;
Mais vous passez votre chemin…
Vous ressemblez à ma jeunesse.
Il y a longtemps
Vous me donniez le bras, nous causions seuls tous deux,
Et les cœurs de vingt ans se font signe bien vite ;
J’en suis encore ému, fille blonde aux yeux bleus ;
Mais vous souviendrez-vous de ma courte visite ?
Hélas ! se souvient-on d’un souffle parasite
Qui n’a fait que passer pour baiser les cheveux,
Du flot où l’on se mire, et de la marguerite
Confidente éphémère où s’effeuillent les vœux ?
Une image en mon cœur peut périr effacée,
Mais non pas tout entière ; elle y devient pensée.
Je garde la douceur de vos traits disparus.
Que je me suis souvent éloigné, l’œil humide,
Avec l’adieu glacé d’une vierge timide
Que je chéris toujours et ne reverrai plus !
Jours lointains
Nous recevions sa visite assidue ;
J’étais enfant. Jours lointains ! Depuis lors
La porte est close et la maison vendue :
Les foyers vendus sont des morts.
Quand j’entendais son pas de demoiselle,
Adieu mes jeux ! Courant sur son chemin,
J’allais, les yeux levés tout grands vers elle,
Glisser ma tête sous sa main.
Et quelle joie inquiète et profonde
Si je sentais une caresse au front !
Cette main-là, pas de lèvres au monde
En douceur ne l’égaleront.
Je me souviens de mes tendresses vagues,
Des aveux fous que je jurais d’oser,
Lorsque, tout bas, rien qu’aux chatons des bagues
Je risquais un fuyant baiser.
Elle a passé, bouclant ma chevelure,
Prenant ma vie ; et, comme inoccupés,
Ses doigts m’ont fait une étrange brûlure,
Par l’âge de mon cœur trompés.
Comme l’aurore étonne la prunelle,
L’éveille à peine, et c’est déjà le jour :
Ainsi la grâce au cœur naissant nouvelle
L’émeut, et c’est déjà l’amour.
En deuil
C’est en deuil surtout que je l’aime :
Le noir sied à son front poli,
Et par ce front le chagrin même
Est embelli.
Comme l’ombre le deuil m’attire,
Et c’est mon goût de préférer,
Pour amie, à qui sait sourire
Qui peut pleurer.
J’aime les lèvres en prière ;
J’aime à voir couler les trésors
D’une longue et tendre paupière
Fidèle aux morts.
Vierge, heureux qui sort de la vie
Embaumé de tes pleurs pieux ;
Mais plus heureux qui les essuie :
Il a tes yeux !
Sonnet
À une belle Enfant
Quand les heures, pour vous prolongeant la sieste,
Toutes, d’un vol égal et d’un front différent,
Sur vos yeux demi-clos qu’elles vont effleurant,
Bercent de leurs pieds frais l’oisiveté céleste,
Elles marchent pour nous, et leur bande au pied leste,
Dans le premier repos, dès l’aube, nous surprend,
Pousse du pied les vieux et les jeunes du geste,
Sur les coureurs tombés passe comme un torrent ;
Esclaves surmenés des heures trop rapides,
Nous mourrons n’ayant fait que nous donner des rides,
Car le beau sous nos fronts demeure inexprimé.
Mais vous, votre art consiste à vous laisser éclore,
Vous qui même en dormant accomplissez encore
Votre beauté, chef-d’œuvre ignorant, mais aimé.
Fleur sans Soleil
Ce qui la peut guérir, cette enfant le repousse.
« Oui, je l’aime, et j’en souffre, et ma douleur m’est douce,
Dit-elle, et j’en veux bien mourir.
Sa voix me donne au cœur une vive secousse,
Mais j’en tressaille avec plaisir.
« Son pas est différent du pas des autres hommes,
Et si j’entends ce bruit près des lieux où nous sommes,
Ma mère, je rougis d’émoi ;
Quand tu parles de lui, quand surtout tu le nommes,
Je baisse les yeux malgré moi.
« S’il connaissait le peu qui me rendrait heureuse,
S’il daignait embellir la tombe qu’il me creuse
D’une fleur de son amitié !
Mais il croit que son âme est assez généreuse
En m’honorant de sa pitié. »
Et sa mère, qui voit sa langueur maladive,
Sa paupière où sans cesse un pleur furtif arrive,
Lui dit tout bas en la priant :
« Viens, quel plaisir veux-tu ? veux-tu que je te suive
Sous un nouveau ciel plus riant ?
— Mon plaisir et mon ciel, mère, c’est ma pensée.
Son image en mon cœur doucement caressée,
Voilà mon plaisir aujourd’hui ! »
Et la mère murmure : « Insensée, insensée,
Tu ne seras jamais à lui. »
Ah ! si jamais des pleurs dont je fusse la cause
Tombaient de tes yeux bleus sur ta poitrine rose,
Jeune fille au naïf tourment ;
Si ta main qui se donne et sur ton cœur se pose
Pour moi sentait un battement ;
Si dans ton âme pure où Dieu seul et ta mère
Gravent leurs noms bénis ; si dans ce sanctuaire
Mon image aussi pénétrait,
Et si tu restais là rêveuse et solitaire
Pour en évoquer chaque trait ;
Si je tenais si bien ta pensée asservie
Qu’un beau voyage au loin ne te fit point envie,
Qu’un autre ciel ne te plût pas,
Et que l’air et le sol n’eussent pour toi de vie
Que par ma voix et par mes pas,
Je te saurais aimer, toi dont l’âme ressemble
À la fleur qui dans l’ombre et se replie et tremble
Et meurt sans le baiser du jour ;
« Viens, te dirais-je, viens, soyons heureux ensemble,
Je t’adore pour ton amour. »
Consolation
Une enfant de seize ans, belle, et qui, toute franche,
Ouvrant ses yeux, ouvrait son cœur,
S’est inclinée un jour comme une fleur se penche,
Agonisante deux fois blanche
Par l’innocence et la langueur.
Ne parlez plus du monde à sa mère atterrée :
Ce qui n’est pas noir lui déplaît ;
Ah ! l’immense douleur que son amour lui crée
N’est-elle pas aussi sacrée
Qu’un seuil de tombe où l’on se tait ?
Vouloir la détourner de son culte à la morte,
C’est toujours l’en entretenir,
Et la vertu des mots ne peut être assez forte
Pour que leur souffle vide emporte
Le plomb fixe du souvenir.
Mais surtout cachez-lui l’âge de votre fille,
Ses premiers hivers triomphants
Au bal, où chaque mère a sa perle qui brille,
Printemps des nuits où la famille
Fête la beauté des enfants.
Ne soyez, en lavant sa blessure cruelle,
Ni le flatteur des longs regrets,
Ni le froid raisonneur dont l’amitié querelle,
Ni l’avocat de Dieu contre elle
Qui saigne encor de ses décrets.
Mais soyez un écho dans une solitude,
Toujours présent, toujours voilé :
Faites de sa souffrance une invisible étude,
Et si le jour lui semble rude,
Montrez-lui le soir étoilé.
La nature à son tour par d’insensibles charmes
Forcera la peine au sommeil ;
Un jour on offre aux morts des fleurs au lieu de larmes…
Que de désespoirs tu désarmes,
Silencieux et fort soleil !
Vous ne distrairez pas les malheureuses mères,
Tant qu’elles pleurent leurs enfants ;
Les discours ni le bruit ne les soulagent guères :
Recueillez leurs larmes amères,
Aidez leurs soupirs étouffants :
Il faut que la douleur par les sanglots brisée
Se divise un peu chaque jour,
Et dans les libres pleurs, dissolvante rosée,
Sur le tombeau qui l’a causée
S’épuise par un lent retour.
Alors le désespoir devient tristesse et plie,
Le cœur moins serré s’ouvre un peu ;
Ce nœud qui l’étreignait doucement se délie,
Et l’âme retombe affaiblie,
Mais plus sage et sereine en Dieu.
La douleur se repose, et d’étape en étape
S’éloigne, et, prête à s’envoler,
Hésite au bord du cœur, lève l’aile et s’échappe ;
Le cœur s’indigne… Dieu qui frappe
Use du droit de consoler.
Mal ensevelie
Quand votre bien-aimée est morte,
Les adieux vous sont rendus courts ;
Sa paupière est close, on l’emporte,
Elle a disparu pour toujours.
Mais je la vois, ma bien-aimée,
Qui sourit sans m’appartenir,
Comme une ombre plus animée,
Plus présente qu’un souvenir !
Et je la perds toute ma vie
En d’inépuisables adieux…
Ô morte mal ensevelie,
Ils ne t’ont pas fermé les yeux !
Qui peut dire
Qui peut dire : Mes yeux ont oublié l’aurore ?
Qui peut dire : C’est fait de mon premier amour ?
Quel vieillard le dira si son cœur bat encore,
S’il entend, s’il respire et voit encor le jour ?
Est-ce qu’au fond des yeux ne reste pas l’empreinte
Des premiers traits chéris qui les ont fait pleurer ?
Est-ce qu’au fond du cœur n’ont pas dû demeurer
La marque et la chaleur de la première étreinte ?
Quand aux feux du soleil a succédé la nuit,
Toujours au même endroit du vaste et sombre voile
Une invisible main fixe la même étoile
Qui se lève sur nous silencieuse et luit…
Telles, je sens au cœur, quand tous les bruits du monde
Me laissent triste et seul après m’avoir lassé,
La présence éternelle et la douceur profonde
De mon premier amour que j’avais cru passé.
FEMMES
Femmes
La Femme
Le premier homme est né, mais il est solitaire.
Il se sent l’âme triste en contemplant la terre :
« Pourquoi tant de trésors épars de tous côtés,
Si je ne peux, dit-il, étreindre ces beautés ?
Ni les arbres mouvants, ni les vapeurs qui courent,
Je ne puis rien saisir des objets qui m’entourent ;
Ils sont autres que moi, je ne les puis aimer,
Et j’en aimerais un que je ne sais nommer. »
Il demande un regard à l’aurore sereine,
Aux lèvres de la rose il demande une haleine,
Une caresse aux vents, et de plus tendres sons
Aux murmures légers qui montent des buissons ;
Des grappes de lilas qu’un vol d’oiseau secoue
Il sent avec plaisir la fleur toucher sa joue,
Et, tourmenté d’un mal qu’il ne peut apaiser,
Il cherche vaguement le bienfait du baiser.
Mais un jour, à ses yeux, la nature féconde
De toutes les beautés qu’il admirait au monde
Fit un bouquet vivant, de jeunesse embaumé.
« Ô femme, viens à moi, s’écria-t-il charmé.
Femme, Dieu n’eût rien fait s’il n’eût fait que la rose :
La rose prend un souffle et ta bouche est éclose ;
Dieu de tous les rayons dispersés dans les cieux
Concentre les plus doux pour animer tes yeux.
Avec l’or de la plaine et le lustre de l’onde
Il fait ta chevelure étincelante et blonde.
Il forme de ton front la paix et la splendeur
Avec un lis nouveau qu’il a nommé candeur,
Et du frémissement des feuilles remuées,
Du caprice des flots et du vol des nuées,
De tout ce que la grâce a d’heureux mouvement
Il forme ta caresse et ton sourire aimant ;
Il choisit dans les fleurs les couleurs les plus belles
Pour en orner ton corps mobile et frais comme elles,
Et la terre n’a rien, ni l’onde, ni l’azur,
Qu’on ne possède en toi plus brillant et plus pur. »
La Puberté
Lorsque la terre entra dans sa vingtième année,
Le premier des printemps couronna son repos,
L’air céleste s’emplit d’odeurs de matinée,
Et la mer, s’étalant, laissa crouler ses flots.
Ce jour-là, dans ta grâce, Ève, tu nous es née.
Depuis lors, comme un peuple innombrable d’échos,
Les couples, répétant ton baiser d’hyménée,
Célèbrent le désir dans la pudeur éclos.
Le cœur ne choisit pas la première qu’il aime,
Et n’importe son nom, sa foi, sa vertu même,
Son baiser c’est le tien qui renaît éternel !
Nous te rêvons présente, éblouis que nous sommes,
Et la virginité de tous les jeunes hommes,
C’est toi qui dans tes bras la remportes au ciel !
INCONSTANCE
Ô reine de mes bien-aimées,
Apprends que je les ai nommées
Des reines aussi tour à tour ;
Chacune est belle et ne ressemble
À nulle autre, et toutes ensemble
Tu les as fait pâlir un jour.
J’aime toujours plus chaque amante ;
Mais plus profondément charmante
Chacune me fait plus souffrir,
Et toi, la dernière venue,
Je t’aime moins que l’inconnue
Qui demain me fera mourir.
L’Abime
L’heure où tu possèdes le mieux
Mon être tout entier, c’est l’heure
Où, faible et ravi, je demeure
Sous la puissance de tes yeux.
Je me mets à genoux, j’appuie
Sur ton cœur mon front agité,
Et ton regard comme une pluie
Me verse la sérénité.
Car je devine sa présence,
Je le sens sur moi promené
Comme une subtile influence,
Et j’en suis comme environné…
Te dirai-je quel est mon rêve ?
Je ne sais, l’univers a fui…
Quand tu m’appelles, je me lève
Égaré, muet, ébloui…
Et bien longtemps, l’âme chagrine,
Je regrette, ennemi du jour,
La douce nuit de ta poitrine
Où je m’abîmais dans l’amour.
Si j’étais Dieu
Si j’étais Dieu, la mort serait sans proie,
Les hommes seraient bons, j’abolirais l’adieu,
Et nous ne verserions que des larmes de joie,
Si j’étais Dieu.
Si j’étais Dieu, de beaux fruits sans écorces
Mûriraient ; le travail ne serait plus qu’un jeu,
Car nous n’agirions plus que pour sentir nos forces,
Si j’étais Dieu.
Si j’étais Dieu, pour toi, celle que j’aime,
Je déploierais un ciel toujours frais, toujours bleu,
Mais je te laisserais, ô mon ange, la même,
Si j’étais Dieu.
Devant un Portrait
Des fluides moments nul ne voit le passage,
Et le printemps des jours s’éteint comme il est né ;
C’est insensiblement, sur le fleuve de l’âge,
Qu’à la froide vieillesse un homme est entraîné.
Mais je me saurai vieux quand cette chère image
Ne me retiendra plus à sa grâce enchaîné,
Et ne recevra plus ce douloureux hommage
D’un sentiment stérile à survivre obstiné :
Ah ! ce jour-là, mon âme aura perdu son aile,
Mon cœur son sang, mes nerfs leur vie et leur ressort ;
Je ne serai plus moi, n’existant plus pour elle.
À quelque homme nouveau j’aurai vendu mon sort,
Ma figure et mon nom, la cendre et l’étincelle,
Et je serai bien vieux, si je ne suis pas mort !
Les voici
Son heureux fiancé l’attend, moi je me cache.
Elle vient ; je l’épie, en murmurant tout bas
Ce reproche, le seul que son oubli m’arrache :
— Vous ne m’aimiez donc pas ?
Les voici tous les deux : ils vont l’un près de l’autre,
Ils se froissent les doigts en cueillant des lilas.
— Vous oubliez le jour où ma main prit la vôtre ;
Vous ne m’aimiez donc pas ?
Heureuse elle rougit, et le jeune homme tremble,
Et la douceur du rêve a ralenti leur pas.
— Vous oubliez le jour où nous errions ensemble ;
Vous ne m’aimiez donc pas ?
Il s’est penché sur elle en murmurant : « Je t’aime !
Sur mon bras laisse aller, laisse peser ton bras. »
— Vous oubliez le jour où j’ai parlé de même ;
Vous ne m’aimiez donc pas ?
Oh ! comme elle a levé cet œil bleu que j’adore !
Elle m’a vu dans l’ombre et me sourit, hélas !
— Que vous ai-je donc fait, pour me sourire encore
Quand vous ne m’aimez pas ?
Jalousie
Je ne me plaindrai point. La pâle Jalousie
Retient sa voix tremblante et pleure un sang muet.
Qu’ils vivent de longs jours, heureux sans poésie,
Et qu’un amour tranquille habite leur chevet !
Qu’il la possède bien, sans l’avoir désirée,
Par le droit seul, exempt du péril de l’aveu,
Sans cette passion folle et désespérée
Qui tente sur le vide une étreinte de feu !
Mais qu’insensiblement le réseau gris des rides
Fatigue le sourire et blesse les baisers ;
Que les cheveux blanchis, les prunelles arides
N’offrent plus que l’hiver à des sens apaisés ;
J’attends, moi, sa vieillesse, et j’en épierai l’heure ;
Et ce sera mon tour ; alors je lui dirai ;
« Je vous chéris toujours, et toujours je vous pleure :
Reprenez un dépôt que je gardais sacré.
« Je viens vous rapporter votre jeunesse blonde :
Tout l’or de vos cheveux est resté dans mon cœur,
Et voici vos quinze ans dans la trace profonde
De mon premier amour patient, et vainqueur ! »
Si je pouvais
Si je pouvais aller lui dire :
« Elle est à vous et ne m’inspire
Plus rien, même plus d’amitié ;
Je n’en ai plus pour cette ingrate ;
Mais elle est pâle, délicate :
Ayez soin d’elle par pitié.
« Écoutez-moi sans jalousie,
Car l’aile de sa fantaisie
N’a fait, hélas ! que m’effleurer ;
Je sais comment sa main repousse,
Mais pour ceux qu’elle aime elle est douce :
Ne la faites jamais pleurer. »
Si je pouvais aller lui dire :
« Elle est triste et lente à sourire ;
Donnez-lui des fleurs chaque jour,
Des bluets plutôt que des roses :
C’est l’offrande des moindres choses
Qui recèle le plus d’amour. »
Je pourrais vivre avec l’idée
Qu’elle est chérie et possédée
Non par moi, mais selon mon cœur…
Méchante enfant qui m’abandonnes,
Vois le chagrin que tu me donnes :
Je ne peux rien pour ton bonheur !
Sonnet
Le vers ne nous vient pas à toute heure et partout,
Et vous ne savez pas combien l’épreuve est rude
De mener sans malheur un sonnet jusqu’au bout
Sur un feuillet d’album impitoyable et prude.
Le plus chétif poète aime à chanter debout,
Seul, et sans contenir sa jeune inquiétude
Ni dépouiller jamais la divine habitude
D’apostropher son monde et de tutoyer tout.
Laissez donc librement voler sa fantaisie,
Car, s’il veut ici-bas goûter la poésie,
Il doit, l’infortuné, la dérober aux cieux ;
Mais vous, que cherchez-vous qui ne soit en vous-même ?
Quand on vous offrirait le plus exquis poème,
On vous rendrait les vers qu’on a lus dans vos yeux.
Sonnet
À Madame A. G. de B.
J’ai l’âme de l’aiglon dont l’aile vigoureuse
Frémit d’impatience aux mains du ravisseur ;
Il lui faut le soleil, la vie aventureuse,
Un vol indépendant ou le plomb du chasseur.
D’un climat sans beaux jours et d’une terre affreuse
L’exil amer pourtant ne m’est pas sans douceur ;
Car l’amitié sait joindre, habile et généreuse,
Les bontés de ma mère aux grâces de ma sœur.
Et vous voulez savoir quel bienfaisant génie,
Égayant de ses yeux l’ombre de ma prison,
Me tint lieu de grand jour, et d’air et d’horizon ?
Eh bien, c’est vous, Madame, et vous êtes bénie
De suppléer si bien famille, amour, printemps,
Patrie et liberté dans les cœurs de vingt ans !
Sonnet
Il a donc tressailli, votre adoré fardeau !
Un petit ange en vous a soulevé son aile,
Vous vous êtes parlé ; le berceau blanc l’appelle,
Et son image rit dans les fleurs du rideau.
Cet enfant sera doux, intelligent et beau,
Si chaque âme s’allume à l’âme maternelle,
Le cœur au feu du cœur et l’œil à la prunelle,
Comme un flambeau s’allume au toucher d’un flambeau.
Ainsi chacun de nous porte son cher poème,
Chacun veut mettre au monde un double de soi-même,
Y déposer son nom, sa force et son amour.
Le plus heureux poème est celui de la mère :
La mère sent Dieu même achever l’œuvre entière,
N’attend qu’un an sa gloire et n’en souffre qu’un jour !
Seul
À Charles Lassis
Le bonheur suit sa pente et rit
Sans témoins, comme un ruisseau coule :
Celui qu’une amante chérit
N’en parle jamais à la foule.
Ô bruit connu d’un léger pas,
Clair baiser d’une bouche rose,
Soupir qui ne se note pas,
Accent qui n’est ni vers ni prose !
Quel chant, quel trouble aérien
Est assez frais pour vous redire ?
Ah ! l’amour est un si grand bien
Que ses heureux n’ont pas de lyre !
Mais celui qui n’est pas aimé,
Qui ne peut embrasser personne,
Étreint un luth inanimé
Qui prenant sa vie en frissonne ;
Dans la gloire il cherche l’oubli
De sa solitude profonde,
Et d’un cœur qui n’est pas rempli
Tend la coupe infinie au monde.
Les Vénus
Je revenais du Louvre hier.
J’avais parcouru les portiques
Où le chœur des Vénus antiques
Se range gracieux et fier.
À ces marbres, divins fossiles,
Délices de l’œil étonné,
Je trouvais bon qu’il fût donné
Des palais de rois pour asiles.
Comme j’allais extasié,
Vint à passer une pauvresse ;
Son regard troubla mon ivresse
Et m’emplit l’âme de pitié :
— Ah ! m’écriai-je, qu’elle est pâle
Et triste, et que ses traits sont beaux !
Sa jupe étroite est en lambeaux ;
Elle croise avec soin son châle ;
Elle est nu-tête ; ses cheveux,
Mal noués, épars derrière elle,
Forment leur onde naturelle :
Le miroir n’a pas souci d’eux.
Des piqûres de son aiguille
Elle a le bout du doigt tout noir,
Et ses yeux au travail du soir
Se sont affaiblis… Pauvre fille !
Hélas ! tu n’as ni feu ni lieu ;
Pleure et mendie au coin des rues :
Les palais sont pour nos statues,
Et tu sors de la main de Dieu !
Ta beauté n’aura point de temple.
On te marchandera ton corps ;
La forme sans âme, aux yeux morts,
Seule est digne qu’on la contemple.
Dispute aux avares ton pain
Et la laine dont tu te couvres :
Les femmes de pierre ont des Louvres,
Les vivantes meurent de faim !
Sonnet
Les villages sont pleins de ces petites filles
Roses avec des yeux rafraîchissants à voir,
Qui jasent en courant sous le toit du lavoir ;
Leur enfance joyeuse enrichit leurs guenilles ;
Mais elles vont bientôt se courber et s’asseoir,
Serves du champ pénible et des vives aiguilles ;
Les vierges ne sont pas, dans les pauvres familles,
Des colombes qu’un grain nourrit de l’aube au soir.
Ô Mort, puisqu’une fois tu leur permis de naître,
Laisse-les vivre en paix leurs quinze ans pour connaître
Des premières amours le ravissant effroi ;
Puis tout à coup prends-les, prends-les toutes ensemble,
Ô Mort ! Paris les compte, il les guette, et je tremble
Que mon propre baiser ne les perde avant toi.
Inconscience
Cette femme a souri quand j’ai passé près d’elle.
Sait-elle qui je suis ? Et si j’étais sans foi,
Sans honneur, sans amour, sans la moindre étincelle
De cœur ni d’âme ! Elle eût encor souri pour moi…
Funeste et ravissante, à l’inconnu qui passe
Sa bouche offre un baiser de poison et de miel,
Et ses yeux bleus, mêlés d’impudeur et de grâce,
Provoquent à la honte avec l’azur du ciel.
Ne vous vantez jamais, ô femmes, d’être belles,
Car ce n’est pas à vous que l’homme en fait honneur ;
Le jour pur et lointain qui luit dans vos prunelles
Ne prend pas sa lumière au feu de votre cœur ;
Vous ignorez le beau dont vous portez la trace ;
Ce que disent vos yeux vous ne le savez pas :
Leur langage n’est point cette irritante audace
Qu’un vaniteux miroir leur enseigne tout bas.
Vous songiez au plaisir, à quelque absurde fête,
Au moment où vos corps nous ont manifesté
Dans les pas, et la taille, et le port de la tête,
Cette divine aisance et cette majesté.
N’ayez jamais d’orgueil de la douleur des hommes,
Quand vous les avez vus pleurer à vos genoux ;
Dieu, l’idéal rêvé, voit la peine où nous sommes :
Il sait bien que c’est lui qui nous tourmente en vous.
Rencontre
Je ne te raille point, jeune prostituée !
Tu vas l’œil provocant, le pied galant et prompt,
À travers le sarcasme et l’ignoble huée :
Ton immuable rire est plus fort que l’affront.
Et moi, je porte au bal le masque de mon front ;
J’y vais, l’âme d’amour à vingt ans dénuée,
Mendier des regards dans la blanche nuée
Des vierges dont jamais les cœurs ne choisiront.
Également parés et dédaignés de même,
Tu cherches ton dîner, moi j’ai besoin qu’on m’aime.
Qui voudra de ton corps ? l’amant heureux te fuit ;
Qui voudra de mon cœur ? l’ange aimé se retire…
Sommes-nous donc voués au glacial délire
Du Désespoir pâmé sur la Faim dans la nuit ?
Hermaphrodite
Il avait l’âme aride et vaine de sa mère,
L’œil froid du dieu voleur qui marche à reculons ;
Il promenait sa grâce, insouciante, altière,
Et les nymphes disaient : « Quel marbre nous aimons ! »
Un jour que cet enfant d’Hermès et d’Aphrodite
Méprisait Salmacis, nymphe du mont Ida,
La vierge, l’embrassant d’une étreinte subite,
Pénétra son beau corps si bien qu’elle y resta !
De surprise et d’horreur ses divines compagnes,
Qui dans cet être unique en reconnaissaient deux,
Comme un sphinx égaré dans leurs chastes montagnes,
Fuyaient ce double faune au visage douteux.
La volupté souffrait dans sa prunelle étrange,
Il faisait des serments d’une hésitante voix ;
L’amour et le dédain par un hideux mélange
Dans son vague sourire étaient peints à la fois.
Son inutile sein n’offrait ni lait ni flamme ;
En s’y posant, l’oreille, hélas ! eût découvert
Un cœur d’homme où chantait un pauvre cœur de femme,
Comme un oiseau perdu dans un temple désert.
Ô symbole effrayant de ces unions louches
Où l’un des deux amants, sans joie et sans désir,
Fuit le regard de l’autre ; où l’une des deux bouches
En goûtant les baisers sent l’autre les subir !
Plus tard
Depuis que la beauté, laissant tomber ses charmes,
N’a plus offert qu’un marbre à mon désir vainqueur ;
Depuis que j’ai senti mes plus brûlantes larmes
Rejaillir froides à mon cœur ;
À présent que j’ai vu la volupté malsaine
Fléchir tant de beaux fronts qui n’ont pu se lever,
Et que j’ai vu parfois luire un enfer obscène
Dans des yeux qui m’ont fait rêver,
La grâce me désole ; et si, pendant une heure,
Le mensonge puissant des caresses m’endort,
Je m’éveille en sursaut, je m’en arrache et pleure :
— Plus tard, me dis-je, après la mort !
Après les jours changeants, sur la terre éternelle,
Quand je serai certain que rien n’y peut finir,
Quand le Temps, hors d’haleine, aura brisé son aile
Sur les confins de l’avenir !
Après les jours fuyants, voués à la souffrance,
Et quand aura grandi comme un soleil meilleur
Le point d’azur qui tremble au fond de l’espérance,
Aube du ciel intérieur ;
Quand tout aura son lieu, lorsque enfin toute chose,
Après le flux si long des accidents mauvais,
Pure, belle et complète, ayant tari sa cause,
Vivra jeune et stable à jamais :
Alors, je t’aimerai sans retour sur la vie,
Sans rider le présent des regrets du passé,
Épouse que mon âme aura tant poursuivie,
Et tu me tiendras embrassé !
MÉLANGES
MÉLANGES
LE LEVER DU SOLEIL
à henri schneider
Le grand soleil, plongé dans un royal ennui,
Brûle au désert des cieux. Sous les traits qu’en silence
Il disperse et rappelle incessamment à lui,
Le chœur grave et lointain des sphères se balance.
Suspendu dans l’abîme il n’est ni haut ni bas ;
Il ne prend d’aucun feu le feu qu’il communique ;
Son regard ne s’élève et ne s’abaisse pas ;
Mais l’univers se dore à sa jeunesse antique.
Flamboyant, invisible à force de splendeur,
Il est père des blés, qui sont pères des races ;
Mais il ne peuple point son immense rondeur
D’un troupeau de mortels turbulents et voraces.
Parmi les globes noirs qu’il empourpre et conduit
Aux blêmes profondeurs que l’air léger fait bleues,
La terre lui soumet la courbe qu’elle suit,
Et cherche sa caresse à d’innombrables lieues.
Sur son axe qui vibre et tourne, elle offre au jour
Son épaisseur énorme et sa face vivante,
Et les champs et les mers y viennent tour à tour
Se teindre d’une aurore éternelle et mouvante.
Mais les hommes épars n’ont que des pas bornés,
Avec le sol natal ils émergent ou plongent :
Quand les uns du sommeil sortent illuminés,
Les autres dans la nuit s’enfoncent et s’allongent.
Ah ! les fils de l’Hellade, avec des yeux nouveaux
Admirant cette gloire à l’Orient éclose,
Criaient : Salut au dieu dont les quatre chevaux
Frappent d’un pied d’argent le ciel solide et rose !
Nous autres nous crions : Salut à l’Infini !
Au grand Tout, à la fois idole, temple et prêtre,
Qui tient fatalement l’homme à la terre uni,
Et la terre au soleil, et chaque être à chaque être !
Il est tombé pour nous, le rideau merveilleux
Où du vrai monde erraient les fausses apparences ;
La science a vaincu l’imposture des yeux,
L’homme a répudié les vaines espérances ;
Le ciel a fait l’aveu de son mensonge ancien,
Et, depuis qu’on a mis ses piliers à l’épreuve,
Il apparaît plus stable, affranchi de soutien,
Et l’univers entier vêt une beauté neuve.
LA CHANSON DE L'AIR
À l’Air, le dieu puissant qui soulève les ondes
Et fouette les hivers,
À l’Air, le dieu léger qui rend les fleurs fécondes
Et sonores les vers,
Salut ! C’est le grand dieu dont la robe flottante
Fait le ciel animé ;
Et c’est le dieu furtif qui murmure à l’amante :
« Voici le bien-aimé. »
C’est lui qui fait courir le long des oriflammes
Les frissons belliqueux,
Et qui fait voltiger sur le cou blanc des femmes
Le ruban des cheveux.
C’est par lui que les eaux vont en lourdes nuées
Rafraîchir les moissons,
Qu’aux lèvres des rêveurs s’élèvent remuées
Les senteurs des buissons.
Il berce également l’herbe sur les collines,
Les flottes sur les mers ;
C’est le breuvage épars des feuilles aux poitrines,
L’esprit de l’univers.
Il va, toujours présent dans son immense empire
En tous lieux à la fois,
Renouveler la vie à tout ce qui respire,
Hommes, bêtes et bois ;
Et dans le froid concert des forces éternelles
Seul il chante joyeux,
Errant comme les cœurs, libre comme les ailes,
Et beau comme les yeux !
PAN
Je vais m’asseoir, l’été, devant les plaines vertes,
Solitaire, immobile, enchanté de soleil ;
Ma mémoire dans l’air par d’insensibles pertes
Se vide ; et, comme un sphinx aux prunelles ouvertes,
Je dors étrangement, et voici mon sommeil :
Ma poitrine s’arrête et plus rien n’y remue ;
La volonté me fuit et je n’ai plus de voix ;
Il entre dans ma vie une vie inconnue,
Ma figure demeure et ma personne mue :
Je suis et je respire à la façon des bois.
Mon sang paraît glisser en imitant la sève ;
J’éprouve que ce monde est vraiment suspendu ;
Quelque chose de fort avec lui me soulève ;
Le regard veille en moi, mais tout le reste rêve.
O Nature, j’absorbe et je sens ta vertu !
Car je suis visité par le même génie
Qui court du blé des champs aux ronces des talus ;
Avec tes nourrissons je bois et communie ;
L’immense allaitement, source de l’harmonie,
Je l’ai goûté, ma mère, et ne l’oublierai plus.
Oh ! que j’avais besoin de t’embrasser, ma mère,
Pour mêler à mon pain ton suc universel,
Ton âme impérissable à mon souffle éphémère,
Et ton bonheur fatal à ma libre misère,
Pour aimer par la terre et penser par le ciel !
NAISSANCE DE VÉNUS
Quand la mer eut donné ses perles à ma bouche,
Son insondable azur à mon regard charmant,
Elle m’a déposée, en laissant à ma couche
Sa fraîcheur éternelle et son balancement.
Je viens apprendre à tous que nul n’est solitaire,
Qu’Iris naît de l’orage et le souris des pleurs ;
L’horizon gris s’épure, et sur toute la terre
L’Érèbe encor brûlant s’épanouit en fleurs.
Je parais, pour changer, reine des harmonies,
Les rages du chaos en flottantes langueurs ;
Car je suis la beauté : des chaînes infinies
Glissent de mes doigts blancs au plus profond des cœurs.
Les parcelles de l’air, les atomes des ondes,
Divisés par les vents se joignent sur mes pas ;
Par mes enchantements comme assoupis, les mondes
Se cherchent en silence et ne se heurtent pas.
Les cèdres, les lions me sentent, et les pierres
Trouvent, quand je les frappe, un éclair dans leur nuit ;
Ardente et suspendue à mes longues paupières,
La vie universelle en palpitant me suit.
J’anime et j’embellis les hommes et les choses ;
Au front des Adonis j’attire leur beau sang,
Et du sang répandu je fais le teint des roses ;
J’ai le moule accompli de la grâce en mon flanc.
Moi, la grande impudique et la grande infidèle,
Toute en chaque baiser que je donne en passant,
De tout objet qui touche apportant le modèle,
J’apporte le bonheur à tout être qui sent.
PLUIE
|
Il pleut. J’entends le bruit égal des eaux ;
|
SOLEIL
À CHARLES DEROSNE
|
Toute haleine s’évanouit,
|
SILÈNE
A H. Chapu
Silène boit. Sa tête est molle sur son cou ;
Dédaigneux d’un soutien, il s’incline et se cambre,
Tend sa coupe en tremblant, lui parle, y goûte l’ambre,
Et vante sa sagesse avec un œil de fou.
Il laisse au gré de l’âne osciller son enflure ;
L’essaim des nymphes rit sur le rideau des cieux :
Tendre, et les doigts errants dans une chevelure,
Il rend grâce à Bacchus qui rajeunit les vieux.
« Chante, chante ! » lui crie, en l’entourant de fête,
Le chœur de la vendange autour de lui dansant ;
Et les enfants, pendus au long poil de sa bête,
Le conjurent aussi de leur babil pressant.
Et lui : « Je chanterai ; mais les strophes dociles
Dans ma tête embaumée aussitôt fleuriront,
Si de ces beaux enfants la troupe aux mains agiles
Unit la rose au pampre et m’en orne le front. »
Ils volent, ravageant le bois et la prairie :
Toute charmille est nue où la bande a passé ;
Puis juchés sur son dos, qui les tolère et plie,
Ils le chargent de pampre à la rose enlacé.
« Chante ! — Je chanterai, si Daphné la farouche,
Nisa l’ingrate, Églé, Néère aux yeux divins,
Mêlent, pour allumer les chansons sur ma bouche,
Le feu de leurs baisers à la douceur des vins. »
Et toutes, comme on voit les jalouses abeilles
Sur un même bouton bruire et se poser,
Sur ses lèvres, qu’il offre encor de jus vermeilles,
Mêlent au feu du vin la douceur du baiser.
« Chante ! — Je vais chanter ; mais la rude secousse
Du pas de ma monture interromprait ma voix. »
Ses indulgents amis le portent sur la mousse,
Et le couchent à l’ombre au bord penchant du bois.
Alors tous, en couronne et l’oreille tendue,
Croient sentir s’éveiller et trembler doucement
La chanson comme un fruit à ses lèvres pendue :
Il s’en échappe un traître et large ronflement.
LES OISEAUX
Montez, montez, oiseaux, à la fange rebelles,
Du poids fatal les seuls vainqueurs !
A vous le jour sans ombre et l’air, à vous les ailes
Qui font planer les yeux aussi haut que les cœurs !
Des plus parfaits vivants qu’ait formés la nature,
Lequel plus aisément plane sur les forêts,
Voit mieux se dérouler leurs vagues de verdure,
Suit mieux des quatre vents la céleste aventure,
Et regarde sans peur le soleil d’aussi près ?
Lequel sur la falaise a risqué sa demeure
Si haut qu’il vît sous lui les bâtiments bercés ?
Lequel peut fuir la nuit en accompagnant l’heure,
Si prompt qu’à l’occident les roseaux qu’il effleure,
Quand il touche au levant, ne sont pas redressés ?
Fuyez, fuyez, oiseaux, à la fange rebelles,
Du poids fatal les seuls vainqueurs !
A vous le jour, à vous l’espace ! à vous les ailes
Qui promènent les yeux aussi loin que les cœurs !
Vous donnez en jouant des frissons aux charmilles ;
Vos chantres sont des bois le délice et l’honneur ;
Vous êtes, au printemps, bénis dans les familles :
Vous y prenez le pain sur les lèvres des filles ;
Car vous venez du ciel et vous portez bonheur.
Les pâles exilés, quand vos bandes lointaines
Se perdent dans l’azur comme les jours heureux,
Sentent moins l’aiguillon de leurs superbes haines ;
Et les durs criminels chargés de justes chaînes
Peuvent encore aimer, quand vous chantez pour eux.
Chantez, chantez, oiseaux, à la fange rebelles,
Du poids fatal les seuls vainqueurs !
A vous la liberté, le ciel ! à vous les ailes
Qui font vibrer les voix aussi haut que les cœurs !
LES FLEURS
Ô poète insensé, tu pends un fil de lyre
À tout ce que tu vois,
Et tu dis : « Penchez-vous, écoutez, tout respire ! »
Hélas ! non, c’est ta voix.
Les fleurs n’ont pas d’haleine ; un souffle errant qui passe
Emporte leurs senteurs,
Et jamais ce soupir n’a demandé leur grâce
Aux hivers destructeurs.
Et cependant les fleurs, d’une beauté si tendre,
Sont-elles sans amour ?
Ne les voyez-vous pas à la chaleur s’étendre
Et se porter au jour ?
L’aube au rire léger, leur mère et leur amie,
Dissipe leur sommeil :
N’a-t-elle pu causer à la moins endormie
Un semblant de réveil ?
Ne concevez-vous point l’âme libre d’idées,
Un cœur, un cœur tout pur,
Des lèvres seulement vers la flamme guidées,
Des fleurs cherchant l’azur ?
Dans la convalescence, où nous vivons comme elles,
Nous laissant vivre en Dieu,
Le plus discret bonjour du soleil aux prunelles
Nous fait sourire un peu ;
Quand la vie a pour nous ses portes demi-closes,
Les plantes sont nos sœurs,
Nous comprenons alors le songe obscur des roses
Et ses vagues douceurs ;
Nous sentons qu’il est doux de végéter encore,
Tant affaibli qu’on soit,
Et de remercier un ami qu’on ignore
D’un baiser qu’on reçoit.
Il est ainsi des fleurs, et ces frêles personnes
Ont leurs menus désirs ;
Dans leur vie éphémère il est des heures bonnes :
Elles ont des plaisirs.
La plante résignée aime où son pied demeure
Et bénit le chemin,
Heureuse de s’ouvrir à tout ce qui l’effleure
Et d’embaumer la main ;
De faire une visite en échangeant un rêve
Sur le vent messager,
Ou d’offrir en pleurant le meilleur de sa sève
A quelque amant léger ;
De dire : « Ah ! cueille-moi, je te rendrai jolie,
Enfant qui peux courir ;
Cela fait voyager d’être par toi cueillie,
Si cela fait mourir :
« Je veux aller au bal, et là dans un beau vase
Régner avec langueur,
Voir le monde, et lui plaire, et finir dans l’extase,
A l’ombre, sur un cœur. »
A DOUARNENEZ EN BRETAGNE
On respire du sel dans l’air,
Et la plantureuse campagne
Trempe sa robe dans la mer,
A Douarnenez en Bretagne.
A Douarnenez en Bretagne,
Les enfants rôdent par troupeaux ;
Ils ont les pieds fins, les yeux beaux,
Et sainte Anne les accompagne.
Les vareuses sont en haillons,
Mais le flux roule sa montagne
En y berçant des papillons,
A Douarnenez en Bretagne.
A Douarnenez en Bretagne,
Quand les pêcheurs vont de l’avant,
Les voiles brunes fuient au vent
Comme hirondelles en campagne.
Les aïeux n’y sont point trahis ;
Le cœur des filles ne se gagne
Que dans la langue du pays,
A Douarnenez en Bretagne.
CHANSON DE MER
Ton sourire infini m’est cher
Comme le divin pli des ondes,
Et je te crains quand tu me grondes,
Comme la mer.
L’azur de tes grands yeux m’est cher :
C’est un lointain que je regarde
Sans cesse et sans y prendre garde,
Un ciel de mer.
Ton courage léger m’est cher :
C’est un souffle vif où ma vie
S’emplit d’aise et se fortifie,
L’air de la mer.
Enfin ton être entier m’est cher,
Toujours nouveau, toujours le même ;
Ô ma Néréide, je t’aime
Comme la mer !
UNE AURORE
A Paul Colin
Le phare sent mourir ses lueurs argentées,
Et du golfe arrondi les pentes enchantées
Vont se dorer dans l’aube où le regard les perd.
Les villages marins dorment. L’Océan vert,
Qui n’a pas de sommeil, fait sa grande descente.
Il réclame son lit, et de loin gémissante
L’onde écume ; elle accourt, s’écroule en s’étalant,
Couvre le fin tapis du sable étincelant,
Et, par un lent retour lavant la plage lisse,
Sous l’onde renaissante, à bout de force, glisse.
Sur la sphère liquide aux éclairs de métaux
Une invisible main fait pencher les bateaux.
Il passe des zéphyrs pleins de fraîcheurs salées.
Et voici que là-bas, par monts et par vallées,
Volent des hommes nus sur des chevaux sans mors ;
Leur galop vers la mer en laboure les bords,
Et de leur bain hardi les joyeuses tempêtes
Aux panaches des flots mêlent les crins des bêtes.
LA FALAISE
Deux hommes sont montés sur la haute falaise ;
Ils ont fermé les yeux pour écouter la mer :
« J’entends le paradis pousser des clameurs d’aise.
Et moi j’entends gémir les foules de l’enfer. »
Alors, épouvantés des songes de l’ouïe,
Ils ont rouvert les yeux sous le même soleil.
L’Océan sait parler, selon l’âme et la vie,
Aux hommes différents avec un bruit pareil.
L’OCÉAN
L’Océan blesse la pensée :
Par la fuite des horizons
Elle se sent plus offensée
Que par la borne des prisons ;
Et les prisons dans leurs murailles
N’ont bruits de chaînes ni sanglots
Pareils au fracas de ferrailles
Que font dans les rochers les flots.
Il faut tenir des mains de femme
Quand on rêve au bord de la mer ;
Alors les horreurs de la lame
Rendent chaque baiser plus cher ;
Alors l’inévitable espace,
Dont l’attrait m’épuise aujourd’hui,
De l’esprit que sa grandeur passe,
Descend au cœur grand comme lui !
Et là tout l’infini demeure,
Toute la mer et tout le ciel !
L’amour qu’on te jure à cette heure,
Ô femme, est immense, éternel.
LA POINTE DU RAZ
Au bout du sombre Finistère,
D’énormes rochers au pied noir
Protègent contre l’eau la terre.
On les entend parler le soir :
« Hélas ! depuis combien d’années
Brisons-nous l’onde au même lieu ?
Toutes les pierres sont damnées,
Les vivants seuls plaisent à Dieu.
« Pour qui faisons-nous sentinelle ?
Pour des favoris étrangers !
Et notre ruine éternelle
Garantit leurs toits passagers.
« Les jours de ces fragiles choses
Ne seront-ils jamais finis ?
Qu’ils s’achèvent ! La fin des roses
Sera le repos des granits.
« Mais patience ! La rancune
Est l’âme du vieil Océan ;
Depuis bien des retours de lune
Le déluge prend son élan ! »
LE LONG DU QUAI
Le long du quai les grands vaisseaux,
Que la houle incline en silence,
Ne prennent pas garde aux berceaux
Que la main des femmes balance.
Mais viendra le jour des adieux ;
Car il faut que les femmes pleurent
Et que les hommes curieux
Tentent les horizons qui leurrent.
Et ce jour-là les grands vaisseaux,
Fuyant le port qui diminue,
Sentent leur masse retenue
Par l’âme des lointains berceaux.
LA NÉRÉIDE
A Emile Javal
Vierge, ton corps, luisant de la fraîcheur marine,
Où l’apporta la vague est à peine arrêté.
À tes mobiles bras, au pli de ta narine
On devine ta race et ta divinité ;
Ô fille de Nérée, on voit que ta poitrine
Se polit au flot grec durant l’éternité.
Ta bouche est plus qu’humaine, et tes vives prunelles
Sont divines ! Leurs feux feraient mûrir nos fruits.
On sent que le caprice est olympique en elles ;
La nature en a fait l’ombre et les étincelles
Avec les éléments des soleils et des nuits :
Ceux qui t’ont regardée, ô nymphe, tu les suis.
Divins aussi tes doigts, artisans de caresse,
Effilés, arrondis par le baiser du flux.
Nous n’en comprenons pas l’opulente paresse :
Nos mains ont travaillé six mille ans révolus,
Et depuis six mille ans la même faim nous presse
Et nous dévorerait si nous ne semions plus.
Nos ancres, en mordant les ténèbres salées,
Ont trouvé plus d’horreur en descendant plus bas.
Elles n’ont pas atteint ces lointaines vallées
Qu’un jour magique emplit, qui roulent sur tes pas
Des ruisseaux de brillants qui ne tarissent pas,
Des sables de corail et d’or dans leurs allées.
Pour nous la mer est triste, et sur les lents vaisseaux
Pleure la solitude aux sombres épouvantes ;
Toi, tu glisses gaîment dans tes profonds berceaux,
Et les molles forêts des campagnes mouvantes
Viennent palper ton sein de leurs lèvres vivantes
Sous les plafonds vitreux et bourdonnants des eaux.
Tu fuis, laissant traîner ta large tresse blonde ;
Ta corbeille de nacre aux tournantes cloisons
Murmure, en moissonnant d’étranges floraisons,
Les lis bleus, les cactus et les roses de l’onde ;
Et jamais les jardins de ce merveilleux monde
N’éprouvent les retours de nos courtes saisons.
Quand notre jour finit, ton aurore commence :
Las d’un brûlant chemin, las d’espace et d’éther,
Le dieu qui fait frémir nos blés dans leur semence
Descend avec délice au fond du lit amer ;
L’abîme vert se teint d’une rougeur immense
Et tout le firmament s’éveille dans la mer.
C’est l’heure où la sirène enchanteresse attire
Les imprudents rêveurs à la poupe inclinés,
Où sur le dos glissant de son affreux satyre
La naïade poursuit les astres entraînés,
Où les monstres nageurs explorent leur empire,
En promenant leurs dieux qui sont les premiers nés.
Leurs dieux leur ont gardé la liberté première,
Quand le jeune chaos, plus hardi que les lois,
Mêlant la terre au ciel et l’onde à la lumière,
Lâchait toute matière au hasard de son poids,
Et, brisant toute écorce où l’âme est prisonnière,
Laissait tous les amours s’échapper à la fois.
Maintenant tout est las, et l’ardente nature
S’affaisse et s’abandonne aux bras morts de l’ennui ;
L’astre accepte son cours, le rocher sa structure,
L’éléphant colossal regrette l’âge enfui ;
Car tous les grands rôdeurs de la haute verdure
S’en vont : des troupeaux vils broutent l’herbe aujourd’hui.
L’Etna dort, et les vents balancent leur fouet lâche ;
La terre est labourée ; à chaque endroit son nom,
Sa ville et ses chemins. L’Océan seul dit : « Non !
Sois riche, ô Terre esclave, en faisant bien ta tâche ;
Je fais ce que je veux. Si ta splendeur me fâche,
J’irai poser ma perle au front du Parthénon ;
« Je franchirai mes murs, si vous passez les vôtres,
Mortels, fils des Caïns et des Deucalions ;
Heurtant vos sapins creux les uns contre les autres,
J’ai vengé votre Dieu de vos rébellions ;
J’ai, comme Orphée, Homère et vos plus grands apôtres,
Sur les monts à mes pieds fait pleurer les lions… »
L’Océan gronde ainsi ; toi, sa nymphe chérie,
Tu ne t’alarmes pas de son courroux divin :
Si ses flots obstinés, redoublant de furie,
En déluge nouveau se répandaient enfin,
Fraîche et levant ta tête au fond des mers fleurie,
Tu presserais encore un immortel dauphin !
LES OUVRIERS
A Louis-Xavier De Ricard
Sur un chemin qu’entoure le néant,
Dans des pays que nul verbe ne nomme,
Chaque astre, mû par des bras de géant,
Roule, poussé comme un roc par un homme.
Terres sans nombre, étoiles et soleils,
Tous, prisonniers d’orbites infinies,
Rouges ou bleus, ténébreux ou vermeils,
Vont lourdement sous l’effort des Génies.
On voit marcher en silence ces blocs.
Quels forts dompteurs, ô monstres, sont les vôtres !
Pas un ne bronche, et sans écarts ni chocs,
Ils tournent tous les uns autour des autres.
Ils tournent tous ; un archange au milieu
Conduit, debout, les formidables rondes ;
Il crie, il frappe, et la comète en feu
N’est que l’éclair de son fouet sur les mondes !
Il fait bondir les fainéants du ciel,
Il ne veut pas qu’un atome demeure ;
A sa main gauche un pendule éternel
Tombe et retombe, et sonne à chacun l’heure.
Holà, Pollux ! où vas-tu, Procyon ?
Plus vite, Algol ! Aldébaran, prends garde !
Mercure, à toi ! Saturne, à l’action !
Dieu vous attend et Képler vous regarde.
Et les géants plissent leurs fronts chagrins ;
Désespérés, ils pleurent et gémissent
En se ruant de l’épaule et des reins ;
Les sphères fuient et les axes frémissent.
A l’œuvre ! à l’œuvre ! ou gare le chaos !
Leur poids les tire au centre de l’espace,
Où l’inertie offre un lâche repos
A la matière éternellement lasse.
Mesurez bien les printemps, les hivers,
L’égal retour des mois et des années :
Un seul retard changerait l’univers
Et briserait toutes les destinées.
Alternez bien les ombres, les lueurs,
Pour ménager tous les yeux qui les goûtent…
Nul peuple, hélas ! ne songe à vos sueurs,
Au long travail que les matins vous coûtent.
Chaque planète à la grâce du sort
Vit, sans bénir les soleils qui remontent ;
Une moitié trafique et l’autre dort,
Et sur demain les multitudes comptent !
LE GALOP
Agite, bon cheval, ta crinière fuyante ;
Que l’air autour de nous se remplisse de voix !
Que j’entende craquer sous ta corne bruyante
Le gravier des ruisseaux et les débris des bois !
Aux vapeurs de tes flancs mêle ta chaude haleine,
Aux éclairs de tes pieds ton écume et ton sang !
Cours, comme on voit un aigle en effleurant la plaine
Fouetter l’herbe d’un vol sonore et frémissant !
« Allons, les jeunes gens, à la nage ! à la nage ! »
Crie à ses cavaliers le vieux chef de tribu ;
Et les fils du désert respirent le pillage,
Et les chevaux sont fous du grand air qu’ils ont bu !
Nage ainsi dans l’espace, ô mon cheval rapide,
Abreuve-moi d’air pur, baigne-moi dans le vent ;
L’étrier bat ton ventre, et j’ai lâché la bride,
Mon corps te touche à peine, il vole en te suivant.
Brise tout, le buisson, la barrière ou la branche ;
Torrents, fossés, talus, franchis tout d’un seul bond ;
Cours, je rêve, et sur toi, les yeux clos, je me penche…
Emporte, emporte-moi dans l’inconnu profond !
INCANTATION
La nuit claire bleuit les feuillages tremblants,
Pose un crêpe mouillé sur les roses bruyères,
Fait luire les talus comme des linges blancs,
Baigne les ravins d’ombre, et d’azur les clairières.
Dans son nimbe nacré la lune resplendit,
Large et lente, effaçant les profondes étoiles ;
La colline se hausse et le vallon grandit ;
L’air froissé d’un vent tiède a des frissons de voiles.
La forêt, fraîche encore après un long soleil,
Répand sa jeune odeur et son goût de résines,
Et grave, balancée en un demi-sommeil,
Écoute chez les morts travailler les racines.
Et le pitre endormi savoure le repos
En un grand palais d’or fait par la main d’un songe.
Mais voici qu’on entend d’eux-mêmes les échos
S’appeler d’un cri pur que le désert prolonge…
Un rire, plus léger que n’est le rire humain,
Vole ; un soupir le suit ; toute la terre chante,
Et tout le ciel devine, en tressaillant soudain,
Qu’une magicienne aux yeux puissants l’enchante.
Un silence effrayant, brusque, interrompt les voix ;
Les astres étonnés s’arrêtent tous ensemble ;
Puis une autre musique étrange monte ; il semble
Que la terre et le ciel s’ébranlent à la fois.
Oui, c’est le bercement d’une valse très lente ;
La forêt en subit l’irrésistible élan :
Elle va, les prés vont, et la lune indolente
Marche, et le zodiaque entraîne l’Océan.
Les vaisseaux, gracieux comme des jeunes filles,
S’éloignent en cadence et deux à deux des ports,
Et, comme en un bassin circuleraient des billes,
Les lies en tournant voyagent bords à bords.
Mais la vitesse accrue avec l’hymne de joie
Précipite la ronde et fait siffler les airs ;
Le sol chancelle et fuit, le firmament tournoie,
Un effréné vertige emporte l’univers.
Dans sa course, la mer, sous les vents qui la rasent,
Allume son phosphore aux subtiles clartés ;
Les étoiles rayant l’immensité l’embrasent,
Et l’arc-en-ciel des nuits rougit ses flots lactés.
C’est la magicienne aux yeux forts qui les guide ;
Debout, elle figure autour d’elle à ses pieds
Un cercle accru toujours et toujours plus rapide
Qui les charme et les traîne à sa vertu liés.
Des poils d’ours et du sang bouillonnent dans un vase.
Cette femme qui tourne enroule à chaque tour
Ses cheveux sur son corps, toute pâle d’extase.
Enfin d’épuisement elle tombe. il fait jour…
La face des ruisseaux brille sous les yeuses ;
Le pâtre réveillé se dresse vers le ciel.
Il se dit : « J’ai rêvé des choses merveilleuses. »
Et le monde est rentré dans son ordre éternel.
LE TRAVAIL
A Emile Perrière
L’humanité fragile a fait ses destinées.
Cette race aux pieds blancs, aux tempes satinées,
Laboure avec l’espoir d’un immense loisir,
Plus grande sans bonheur que son Dieu sans désir.
Cette vie éphémère, insatiable et tendre,
Qui lui fut imposée, elle a su la défendre ;
Et son dur créateur, l’affamant sans pitié,
Père avare d’amour n’est père qu’à moitié.
Mais, s’il croit que son œuvre est parfaite, qu’il dorme !
Nous lutterons plus beaux contre la terre informe,
L’eau du ciel, et des nuits le tombeau quotidien.
Nous sommes, c’est assez, nous ne voulons plus rien ;
Nous prenons son ébauche à ce point ; qu’il abdique !
Nous acceptons de lui cette faveur unique
Que tous les lendemains soient exacts au réveil,
Et que toujours sauvés des ombres du sommeil
Nous retrouvions toujours la tâche commencée,
L’air, et nos seuls flambeaux, l’azur et la pensée.
MON CIEL
A Adolphe Lepley
J’aime d’un ciel de mai la fraîcheur et la grâce ;
Mais, quand sur l’infini mon cœur a médité,
Je ne peux pas longtemps affronter de l’espace
La grandeur, le silence et l’immobilité.
Pascal sombre et pieux me rend pusillanime,
Il me donne la peur et me laisse effaré
Quand il porte au zénith et lâche dans l’abîme
L’homme superbe et vain, misérable et sacré.
Comme le nouveau-né, dont le regard novice
Dans l’ombre du néant paraît encor nager,
Par un avide instinct s’attache à sa nourrice
Et fuit dans sa poitrine un visage étranger ;
Comme le moribond sur ce qui l’environne
Porte des yeux troublés par la funèbre nuit,
Et, dans l’éternité suspendu, se cramponne
A l’heure, à la minute, à l’instant qui s’enfuit ;
Ainsi, devant le ciel où j’épelle un mystère,
Jouet de l’ignorance et du pressentiment,
J’appuie, épouvanté, mes mains contre la terre ;
Ma bouche avec amour la presse aveuglément.
Tremblant, je me resserre en mon étroite place
Je ne veux respirer qu’en mon humble milieu ;
Il ne m’appartient pas de voir le ciel en face :
La profondeur du ciel est un regard de Dieu ;
Non de ce Dieu vivant qui parle dans la Bible,
Mais d’un Dieu qui jamais n’a frappé ni béni,
Et dont la majesté dédaigneuse et paisible
Écrase en souriant l’homme pauvre et fini.
Garde au faite sacré ta solitude altière,
O Maître indifférent dans ta force endormi ;
Moi, je suis homme, il faut que je souffre et j’espère ;
J’ai besoin de pleurer sur le front d’un ami.
A moi l’ombre des bois où le rayon scintille,
A toi du jour d’en haut l’immense égalité ;
A moi le nid bruyant de ma douce famille,
A toi l’exil jaloux dans ta froide unité.
Tu peux être éternel, il est bon que je meure :
L’évanouissement est frère de l’amour ;
J’ai laissé quelque part mes dieux et ma demeure :
Le charme de la mort est celui du retour.
Mais ce n’est pas vers toi que la mort nous ramène :
Tes puissants bras sont faits pour ceindre l’univers ;
Ils sont trop étendus pour une étreinte humaine,
Nul n’a senti ton cœur battre en tes flancs déserts.
Non, le paradis vrai ressemble à la patrie :
Mon père en m’embrassant m’y viendra recevoir ;
J’y foulerai la terre, et ma maison chérie
Réunira tous ceux qui m’ont dit : Au revoir.
En moi je sentirai les passions renaître
Et la chaude amitié qui ne trahit jamais,
Et tu m’y souriras la première peut-être,
O toi qui sans m’aimer as su que je t’aimais !
Mais je n’y veux pas voir la nature amollie
Par la tiède fadeur d’un éternel printemps :
J’y veux trouver l’automne et sa mélancolie,
Et l’hiver solennel, et les étés ardents.
Voilà mon paradis, je n’en conçois pas d’autre :
Il est le plus humain s’il n’est pas le plus beau ;
Ascètes, purs esprits, je vous laisse le vôtre,
Plus effrayant pour moi que la nuit du tombeau.
A UN TRAPPISTE
Mon corps, vil accident de l’éternel ensemble ;
Mon cœur, fibre malade aux souffrantes amours ;
Ma raison, lueur pâle où la vérité tremble ;
Mes vingt ans, pleurs perdus dans le torrent des jours :
Voilà donc tout mon être ! et pourtant je rassemble
Ma volonté, ma force, et mes instants si courts,
Pour illustrer ma vie, et la gloire me semble
Un rempart où la mort s’arrêtera toujours.
Et vous, vous ne voyez, mon frère, dans la gloire
Que d’un mérite vain la palme dérisoire,
Caprice de la foule et du temps et du lieu.
Dédaigneux des vertus que le monde renomme,
Vous dites que la gloire est l’estime de l’homme,
Et que la paix de l’âme est l’estime de Dieu.
SONNET
A Joseph De Laborde
En ce moment, peut-être, un fils de l’Italie
Maudit l’égalité d’un firmament trop pur ;
Il désire la France, où la femme est jolie,
Où le vol du nuage égayé un tiède azur.
Et moi, je suis en France et je songe à Tibur ;
Je hais nos jours troublés, le bruit de notre vie ;
La femme est belle à Rome, et je me meurs d’envie
De fuir nos froids soleils et notre ciel obscur.
Ainsi vont se croisant les vains soupirs des hommes.
Nous nous plaindrons toujours de la place où nous sommes,
Nos pieds ont leur patrie et nos rêves la leur.
La jeune fantaisie est féconde en merveilles,
Mais où l’on doit aimer les peines sont pareilles :
On quitte son pays, on emporte son cœur.
LE PASSÉ
Parfois à mon Passé je vais dire à l’oreille :
« Je ne suis pas heureux, parlons des premiers jours. »
Et le dormeur couché que ma prière éveille
Se dresse avec lenteur en frottant ses yeux lourds.
Puis joyeux, rajustant ses printaniers atours,
Encore un peu lassé des fêtes de la veille,
Il vole, et me conduit de merveille en merveille
Sous des cieux oubliés pleins de ses nuits d’amours.
Il rallume les feux, remplit de vin la coupe,
Met à flot la gondole, orne de fleurs la poupe,
Se renverse en chantant, et bat le flot qui dort ;
Et je veux l’embrasser, mais je ne prends pas garde
Que tout en souriant mon Passé me regarde
D’un œil terne, immobile, où je sens qu’il est mort.
LA TRACE HUMAINE
Nous marchons : devant nous la poussière se lève,
Elle reçoit nos pas et les ensevelit ;
Mais l’espace nous suit sans rupture ni trêve :
Il sait quel long voyage un seul homme accomplit.
Tant de pieds ont déjà foulé la même place
Que les grains du pavé ne les nombreraient pas.
Si chaque homme après soi laissait partout sa trace,
Quels bizarres circuits vous feriez sur ses pas !
L’un vous imposerait un va-et-vient fidèle
De son lit au comptoir, du comptoir à son lit ;
L’autre vous mènerait, de semelle en semelle,
De son grenier natal au palais qu’il remplit.
Vous iriez de la Bourse au parapet du fleuve,
D’un seuil tendu de noir au rendez-vous d’amour,
Et de combien d’enfants la marque toute neuve
Finirait brusquement sans suite et sans retour !
Hélas ! prompte et mêlée, ou lente et solitaire,
Par chaque homme traînée aussi loin qu’il a pu,
La trace disparaît en un point de la terre,
Comme un fil embrouillé, subitement rompu.
Mais je crois que ce fil de nos vagabondages
Fuit par delà ce monde et n’est jamais cassé,
Et qu’il relie entre eux dans la nuit des vieux âges
D’innombrables soleils où nous avons passé.
L’OMBRE
A José-Maria De Heredia
Notre forme au soleil nous suit, marche, s’arrête,
Imite gauchement nos gestes et nos pas,
Regarde sans rien voir, écoute et n’entend pas,
Et doit ramper toujours quand nous levons la tête.
A son ombre pareil, l’homme n’est ici-bas
Qu’un peu de nuit vivante, une forme inquiète
Qui voit sans pénétrer, sans inventer répète,
Et murmure au Destin : « Je te suis où tu vas. »
Il n’est qu’une ombre d’ange, et l’ange n’est lui-même
Qu’un des derniers reflets tombés d’un front suprême ;
Et voilà comment l’homme est l’image de Dieu.
Et loin de nous peut-être, en quelque étrange lieu,
Plus proche du néant par des chutes sans nombre,
L’ombre de l’ombre humaine existe, et fait de l’ombre.
PAYSAN
A François Millet
Que voit-on dans ce champ de pierres ?
Un paysan souffle, épuisé ;
Le hâle a brûlé ses paupières ;
Il se dresse, le dos brisé ;
Il a le regard de la bête
Qui, dételée enfin, s’arrête
Et flaire, en allongeant la tête,
Son vieux bât qu’elle a tant usé.
La Misère, étreignant sa vie,
Le courbe à terre d’une main,
Et, fermant l’autre, le défie
D’en ôter, sans douleur, son pain.
Il est la chose à face humaine
Qu’on voit à midi dans la plaine
Travailler, la peau sous la laine
Et les talons dans le sapin.
Soyez riches sans trop de joie ;
Soyez savants, mais sans fierté :
L’heureux a cru choisir la voie
Où de doux fleuves l’ont porté.
On hérite d’un sang qu’on vante ;
On rencontre ce qu’on invente ;
Et je cherche avec épouvante
Les œuvres de ma liberté…
Brave homme, le rire et les larmes
Sont mêlés par le sort distrait ;
Nous flottons tous, dans les alarmes,
Du vain espoir au vain regret.
Et, si ta vie est un supplice,
Nos lois ont un divin complice :
Fait-on le mal avec délice ?
Fait-on le bien comme on voudrait ?
AU BAL DE L'OPÉRA
Impression
En place pour le chaud quadrille !
En avant l’ivrogne et la fille !
Qu’on se désarticule et qu’on se déshabille !
Car l’homme est l’être le plus beau,
Le seul dont l’âme espère et se dise immortelle,
Le seul qui lève sa semelle
A la hauteur de son cerveau,
Qui s’ennuie en plein jour et qui rie aux étoiles.
Qui soit en rut sans gravité,
Le seul des animaux qui se soit fait des voiles
Pour jouir de la nudité !
SURSUM
A Léon Renault
On dit qu’importuné dans la paix de sa glace
Le mont Blanc voit gravir tous les ans sa paroi
Par des aventuriers pleins d’orgueil et d’effroi,
Et la foule murmure : « A quoi bon cette audace ? »
Là, dans l’éternité, tombe, s’amasse et dort
La neige au morne éclat, ce deuil blanc des montagnes
Qui souffrent d’assister aux saisons des campagnes
Et de subir l’ennui d’un immuable sort.
Ici, la vie abonde, active, aimante et belle,
La querelle des vents est la gaîté de l’air ;
Le soleil, qui plus haut laisse planer l’hiver,
N’est chaud que pour la plaine et fécond que pour elle.
Pourquoi, fuyant l’été, gagner les sommets froids,
Poursuivre en longs circuits de rares échappées,
Suspendre la frayeur aux pentes escarpées,
Et s’efforcer au ciel par des sentiers étroits ?
Toujours le ciel se ferme aux bornes de la terre ;
Rien ne sert, pour l’ouvrir, d’élargir l’horizon.
Aimons plutôt : le cœur a besoin de prison :
Dès que le mur s’éloigne, il se sent solitaire. »
Ainsi, les yeux levés, pâle, sans air ni feu,
Monte aux faites muets l’âpre Philosophie,
Et la Volupté roule au vallon de la vie,
Sans songer qu’elle y boit dans la coupe de Dieu.
Mais, tous les ans encor, des hommes fous d’espace
Iront, la pique au poing, sur les plateaux des monts
D’où volent les regards, jetés comme des ponts
Qui portent l’âme à Dieu sur le printemps qui passe.
Là, ces fiers pèlerins n’ont d’ombre que la leur ;
Nul ne rit de l’extase où leur âme se noie ;
Et, s’ils n’entendent plus les hymnes de la joie,
Ils ne frémissent plus des cris de la douleur.
Ils sont loin des savants dont la main sèche tremble,
Loin des hommes de doute heureux d’un vain baiser ;
Mais, forts d’un grave amour, ils viennent seuls poser
Sur l’immense inconnu l’œil et le cœur ensemble.
Ils n’ont pas de repos s’ils ne l’embrassent tout.
La brume quelquefois les aveugle et les trempe.
Ils vont. La plaine utile est un trésor qui rampe ;
Les monts sont des déserts, mais des déserts debout.
A UN DÉSESPÉRÉ
Tu veux toi-même ouvrir ta tombe :
Tu dis que sous ta lourde croix
Ton énergie enfin succombe ;
Tu souffres beaucoup, je te crois.
Le souci des choses divines
Que jamais tes yeux ne verront
Tresse d’invisibles épines
Et les enfonce dans ton front.
Tu répands ton enthousiasme
Et tu partages ton manteau ;
À ta vaillance le sarcasme
Attache un risible écriteau.
Tu demandes à l’âpre étude
Le secret du bonheur humain,
Et les clous de l’ingratitude
Te sont plantés dans chaque main.
Tu veux voler où vont tes rêves
Et forcer l’infini jaloux,
Et tu te sens, quand tu t’enlèves,
Aux deux pieds d’invisibles clous.
Ta bouche abhorre le mensonge,
La poésie y fait son miel ;
Tu sens d’une invisible éponge
Monter le vinaigre et le fiel.
Ton cœur timide aime en silence,
Il cherche un cœur sous la beauté ;
Tu sens d’une invisible lance
Le fer froid percer ton côté.
Tu souffres d’un mal qui t’honore ;
Mais vois tes mains, tes pieds, ton flanc :
Tu n’es pas un vrai Christ encore,
On n’a pas fait couler ton sang ;
Tu n’as pas arrosé la terre
De la plus chaude des sueurs ;
Tu n’es pas martyr volontaire,
Et c’est pour toi seul que tu meurs.
INDÉPENDANCE
Pour vivre indépendant et fort
Je me prépare au suicide ;
Sur l’heure et le lieu de ma mort
Je délibère et je décide.
Mon cœur à son hardi désir
Tour à tour résiste et succombe :
J’éprouve un surhumain plaisir
A me balancer sur ma tombe.
Je m’assieds le plus près du bord
Et m’y penche à perdre équilibre ;
Arbitre absolu de mon sort,
Je reste ou je pars. Je suis libre.
Il est bon d’apprendre à mourir
Par volonté, non d’un coup traître :
Souffre-t-on, c’est qu’on veut souffrir ;
Qui sait mourir n’a plus de maître.
SUR UN VIEUX TABLEAU
A Alfred Ruffin
C’est, à peu près, Montmartre, en été, les dimanches
Jérusalem rayonne au loin ;
Les gibets sont bien droits sur des dalles bien blanches ;
Le brin d’herbe est fait avec soin ;
Un fort joli sentier conduit à la montagne,
Ceux-ci viennent, ceux-là s’en vont ;
Une fillette a l’air de dire à sa compagne :
« Viens-tu voir là-haut ce qu’ils font ? »
On sent la cruauté des fêtes triviales :
Sous les mourants verts et ridés,
Des soldats efflanqués aux lèvres joviales
Se penchent sur un coup de dés.
Marie est sans beauté, car la vieillesse est laide ;
Elle faiblit tout simplement ;
Un groupe désolé pleure et lui vient en aide,
Et c’est sublime exactement.
Enfin l’artiste est là (car il s’est peint lui-même),
Casque en tête, au bas du tableau ;
Il saluerait son Dieu, si par candeur suprême
Il ne se fût peint en bourreau.
Ainsi le peuple court, la ville est très vivante,
Pendant que Jésus boit son fiel.
Tout est vrai, tout est simple. Une chose épouvante :
Le bleu limpide et froid du ciel.
C’est moins ce front pâli, mordu par les épines,
Cet œil noyé d’un pleur vermeil,
Ce sont moins ces soudards aux sordides rapines
Qui navrent, que ce plat soleil.
Il est affreux de voir, en face du martyre,
Le médiocre aller son train ;
On sent que l’Espérance à pas lents se retire,
Prise d’un dédaigneux chagrin.
Oh ! par pitié, la foudre, et les vents, et la pluie !
Le ciel a sa tâche à remplir :
Ce Christ est mort, c’est fait ; qu’au moins son Dieu l’essuie
Après l’avoir laissé salir !
Qu’il défende à l’azur de jouer sur ses côtes,
A son sang noir de dégoutter !
Que tous ces paysans rachetés de leurs fautes
Aient un peu l’air de s’en douter !
Qu’on voie au noir zénith resplendir une palme,
Et tous les spectres se lever
Pour accuser le jour d’avoir avec ce calme
Laissé ce crime s’achever !
Mais le cri de Jésus ne troublait point les mondes :
Ils sont esclaves de leur poids ;
Et les os demeuraient dans les bières profondes,
Car c’est de la chaux dans du bois.
Le Golgotha brillait, car les rayons solaires
Laissent l’ombre dans les lieux bas ;
Les badauds allaient voir, car les hommes d’affaires
Pour un pendu ne sortent pas ;
Une mère pleurait, l’événement l’explique :
Son fils mourait, bien qu’il fût Dieu ;
Elle avait mal compris cette métaphysique,
Car les femmes raisonnent peu.
Ces bourreaux devaient tous frapper dans l’ignorance,
Car le Juif était condamné,
Mettre au sort son manteau pour tous sans préférence,
Puisqu’ils l’avaient tous profané.
Le peintre a bien surpris, dans son horreur naïve,
Le vrai moment du désespoir :
Quand le monde est bruyant et la lumière vive,
Le fond du cœur muet et noir ;
Quand parmi ces passants tout entiers à la vie
Seul on souhaite et craint la mort,
Qu’on porte à la matière une ironique envie
Comme si l’idée avait tort,
Et qu’on est près d’aller mendier la justice
Comme l’aumône et le pardon,
Parce que l’âme enfin doute et se rapetisse
Dans le néant de l’abandon.
Dans les premiers venus vous rêviez des apôtres :
Ils se sont sauvés, les peureux !
A moins qu’ils n’aient vendu votre pensée aux autres
Sous un verbe scellé par eux.
Vous croyez que le peuple est en secret fidèle
Aux révoltés de la vertu :
Non, il résiste au bien comme une citadelle,
Sans même l’avoir combattu.
Quand il vous a souillé le fronf et la tunique,
Donné le sceptre de bois vert,
Il trouve merveilleux que la place publique
Vous charme moins que le désert.
Harangueur d’un flot tiède et qui toujours recule,
Vous lui dites : « J’aime et je crois ! »
Vos attendrissements vous ont fait ridicule
Jusque dans les douleurs de croix.
TOUJOURS
Tu seras éternellement,
Qu’on te nomme esprit ou matière ;
Cette vie est un court moment
De l’existence tout entière.
Prends une pierre et brise-la,
Prends les morceaux, mets-les en poudre :
La même pierre est toujours là,
Tu ne peux rien que la dissoudre ;
Livre ton âme à des amours
Qui la brisent et l’exténuent :
Elle demeure, elle est toujours,
Il n’est point de maux qui la tuent.
En te perçant le cœur tu fuis ;
Mais l’assassin reste : c’est elle,
Obstinée à crier : « Je suis ! »
Et cruellement immortelle.
D’un ciel rêvé toujours banni,
Cloué par l’étude au mystère,
Sans but ni halte, à l’infini
Tu traîneras de terre en terre.
Tu ne peux mourir qu’un moment,
Un fouet voltige sur ton somme…
Oh ! penser éternellement !
Je suis épouvanté d’être homme.
EN AVANT
SÉSAME
Quand chaque nuit d’ardente veille
Avancerait d’un jour ma mort,
Ma volonté serait pareille
D’ébranler le cœur par l’oreille,
Et je mourrais dans un accord.
J’ai bien payé dans ma journée
Le tribut des bras au labour ;
La nuit change ma destinée,
Et dans mon âme illuminée
Seul je descends avec amour.
« Ouvre-toi, Sésame ! » La porte
Aussitôt roule sur ses gonds.
J’entre et j’appelle : à ma voix forte
Mon peuple innombrable m’escorte,
Sombres pensers et rêves blonds.
Et nous allons à perdre haleine
(L’âme a la profondeur des cieux) ;
Là je traîne Hector dans la plaine,
Je lave les pieds blancs d’Hélène,
Je jure en tutoyant les dieux !
Sous le sceptre du roi d’Ithaque
Je brise un Thersite ennuyeux ;
J’apostrophe un roi, je l’attaque,
Et, l’œil chargé d’un voile opaque,
Il tombe en nommant ses aïeux.
Je n’ai qu’à vouloir et vous êtes,
Et je vous bâtis des palais,
Vierges pures, j’orne vos têtes
Et je vous convie à des fêtes
Dont vous ne rougissez jamais.
Là, loin des cupidités viles
Qui divisent les cœurs étroits,
J’aime à fonder d’immenses villes
Où sur des tables immobiles
Les devoirs ont borné les droits.
Ainsi, rêvant des lois meilleures,
Compagnon des plus grands mortels,
Dans mon âme aux vastes demeures
Je m’abîme, oubliant les heures,
Le vrai monde et les maux réels…
Mais l’aube ordonne que j’en sorte…
O ciel ! j’ai laissé fuir au vent,
Dans le délire qui m’emporte,
Le mot qui fait tourner la porte,
Et me voilà muré vivant ! - FIN
Ajouter un commentaire